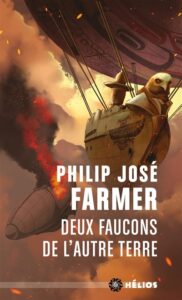De Terence Young, 1962.
De Terence Young, 1962.
Entamons ensemble un nouveau format sur ce blog, consacré à des séries et/ou à ce qu’il est convenu d’appeler désormais des univers étendus. Mais plutôt que de commencer de manière assez convenue par Star Wars, Marvel ou la Terre du Milieu, autant aller vers quelque chose de plus surprenant en se lançant dans la saga James Bond. Composée de 25 films produits par Eon, deux films indépendants (Casino Royale en 1967 et Never Say Never Again en 1983), de 12 romans et deux recueils de nouvelles signés Ian Fleming, la saga Bond fait partie de l’imaginaire collectif mondial depuis plus de 60 ans maintenant, ayant d’abord passionné les britanniques en mal de sensation à travers une série de romans de gare débutée dans les années 50 avant de changer drastiquement la forme des films d’action à partir des années 60, créant de nombreuses émules à travers les décennies, sans parler des nombreuses parodies assumées ou non assumées.
Le personnage de James Bond est par ailleurs devenu un archétype, un mythe moderne. Bien qu’absent des écrans depuis quelques années déjà, en l’attente de la perle rare qui remplacera Daniel Craig, Bond n’en demeure pas moins une valeur sûre de l’imaginaire collectif. Depuis quatre ou cinq générations maintenant, chacune a « son » Bond, qu’elle considère forcément le meilleur interprète, la meilleure version de l’espion britannique. Il est également l’image d’un idéal masculin relativement passéiste, où violence, alcool, répartie et une certaine forme de misogynie faisaient encore un cocktail attirant. Et la saga a également forgé une certaine forme de l’idéal féminin, à travers les multiples James Bond Girls, qui ont bien davantage évoluées au fil des décennies que leur partenaire de jeu. Bond est aussi une certaine idée de l’empire britannique, de la civilisation occidentale, de l’ostracisme exotique, concepts sentant le souffre dans le débat public d’aujourd’hui, mais que la saga a fait évoluer bon gré mal gré au fil des décennies. Bref, au-delà d’être une série de film d’action à grand budget, passant du film d’espionnage à la légère anticipation, c’est aussi un miroir : la saga Bond nous parle du temps du passe, de l’évolution de mœurs et des valeurs et, sur le tard, du décalage inévitable que les changements toujours plus rapides de ces valeurs provoquent.
Mais comme il faut bien commencer quelque part, parlons du premier film tiré des aventures littéraires de Fleming, à savoir Dr. No, plus connu en francophonie sous le titre de James Bond 007 contre Dr. No, puisque nous préférons apparemment être explicite dans nos serials. Ce premier opus, réalisé avec un budget modeste, est pour sa plus grande partie un film policier/d’espionnage britannique classique : à part quelques séquences tournées directement en Jamaïque pour assurer le dépaysement exotique du spectateur en salle de cinéma, la majeure partie de l’intrigue est une suite assez simple et explicites de scènes en intérieur où Bond, envoyé par son patron londonien pour enquêté sur la disparition inexplicable d’un agent de liaison et de sa secrétaire au bureau de Kingston, interroge des témoins, relève des preuves, explore des pistes et confirme des hypothèses. Même le Dr. No, dans la dernière partie davantage « grand spectacle » du long métrage, ne s’y trompe pas : il réduira l’espion élégant à « un stupide policier« .
Ce qui aurait pu se résumer à un film d’enquête avec un soupçon d’aventure est cependant complètement sublimé par une série de choix, choix pour partie issus des romans de Fleming et, pour une autre partie, créés par l’alliance créative de Terence Young et des producteurs Harry Saltzman et Albert R. « Cubby » Broccoli. Le réalisateur, de la vieille école anglaise, début à l’orée des années 50 par quelques films noirs et quelques films de guerre dont l’Histoire du 7ème art à perdu la trace. Il enchaîne ensuite avec des films d’aventure et des drames avant d’atterrir, un peu par hasard, sur l’adaptation du premier Bond au cinéma, alors que la saga est déjà depuis quelques années un succès de librairie en Grande-Bretagne (essentiellement). Bizarrement, le choix est fait d’adapter non le premier des romans (Casino Royale, 1953), mais le sixième tome, Dr No, publié quatre ans avant. Probablement parce que le cadre du roman est plus exotique, ajoutant un argument commercial au film. Je disais juste avant que Terence Young est tombé par hasard dans le projet, mais ce n’est évidemment pas tout à fait vrai. Broccoli, qui avait réussi à sécuriser les droits d’adaptation de la série (on verra les années suivantes que ce n’est pas tout à fait aussi simple), a débuté sa carrière de producteur par le film de guerre Les Bérets rouges, réalisé par Terence Young en 1953, avant de produire trois autres de ses films en 1956 et 1958. Donc les deux hommes se connaissent et savent travailler ensemble, ce qui semble être un grand avantage si l’on se fie à la réputation difficile de Broccoli comme producteur.
Et les deux hommes (Saltzman joue bien sûr également un rôle, mais de moindre importance créative) ont le génie créatif, l’intuition incroyable, peut-être dictée par des restrictions budgétaires ou par des conditions de plateau particulières, de mettre dès ce premier opus en place un certain nombre de tropes bondiens qui seront la marque de fabrique de la saga. Ainsi, le générique hyperstylisé, précédé de la fameuse scène où Bond tire sur le spectateur dans ce qui semble être le viseur d’un fusil, sont déjà là. Draguer Moneypenny également, tout comme la relation d’amitié et de mépris respectif entre Bond et son supérieur, M, qui n’est ici pas nommé. Mais bien davantage que ces gimmicks, c’est le casting parfait de Sean Connery, alors relativement inconnu, dans le rôle-titre qui marquera le personnage et son univers de manière tellement profonde que ses successeurs ne pourront se définir que par leurs traits communs ou divergents. Connery est sûr de lui, impulsif, dragueur, à la boisson facile, profite des femmes et use, par ailleurs, très explicitement de son permis de tuer. Ainsi cette scène où il tue de sang-froid un adversaire désarmé alors même qu’il n’a pas obtenu réponse à ses questions. On trouve encore dans ce Dr. No le premier usage de « la réplique qui tue« , ici incarnée par la réponse de Bond à un passant qui assiste, médusé, à l’explosion d’un corbillard en contrebas d’un fossé dans lequel trois assassins envoyés pour supprimer l’espion anglais périssent dans les flammes, situation à laquelle Bond répondra par un flegmatique « I think they were on the way to a funeral« .
On retrouve également les premières James Bond girls : Eunice Gayson, la riche Sylvia Trench qui tombe sous le charme de Bond et qui disparait de l’intrigue après quelques scènes, Zena Marshall, la traitresse que Bond consomme allègrement avant de l’envoyer paitre (au moins celle-ci survit, ce qui ne sera pas le cas de nombre d’autres James Bond Girls dans ce rôle) et enfin, la sculpturale Ursula Andress, dont c’est ici le premier rôle d’importance au cinéma, dans le rôle de l’iconique Honey Ryder (iconique sortie des eaux de la Mer des Caraïbes en bikini blanc). Et contrairement à ce que l’image d’Epinal laisse penser, ces dames, à l’exception sans doute de la facile Sylvia Trench au début de l’épisode, sont plus complexes que ce que l’on imagine. Honey Ryder, en particulier, malgré son patronyme ridicule, n’est pas juste une « Damsel in distress« . Elle aussi une femme indépendante qui sait faire usage de violence quand il le faut. J’avais totalement oublié ce cours passage où elle explique avoir été violée par son propriétaire après le décès de son père et s’être vengé en le tuant avec une veuve noire dans les jours suivants (histoire à laquelle Bond répond de manière assez amusée « Well, it wouldn’t do to make a habit of it« ). Et bien que son rôle reste relativement anecdotique, s’inscrivant dans le film un peu par hasard, elle n’en demeure pas moins elle aussi un modèle auquel toutes les autres actrices endossant ce rôle parfois ingrat de l’objet du désir seront comparées impitoyablement au fil des décennies.
Reste bien sûr un dernier trope bondien encore à commenter ici : le vilain (mot beaucoup plus adéquat que méchant). Et c’est le Dr. No qui donne son nom au film qui a le grand avantage d’ouvrir le bal. Génie criminel froid et calculateur, il introduit par ses inévitables monologues explicatifs non seulement ses plans machiavéliques pour détourner les fusées américaines de leur objectif, mais également l’organisation SPECTRE, qui donnera quelques-uns des méchants les plus mémorables de la saga. Pourtant, ce n’est pas le point fort de ce premier opus. Arrivant très tard dans le long métrage, il n’y a finalement que peu de scènes pour imposer un souvenir vivace dans l’esprit des spectateurs. Il a bien sûr une base secrète over-the-top et se délecte d’un échange intellectuello-cynique avec Bond, mais il est aussi assez anecdotique. La scène du repas partagé, où l’on insiste sur ses mains robotiques, perdues apparemment à cause d’un incident dû à la radiation nucléaire, est nettement plus satisfaisante que la confrontation finale avec Bond dans la salle du réacteur nucléaire, assez mal chorégraphiée et finalement peu spectaculaire. Mettons cela sur le compte du peu de moyens alloués à ce premier long métrage, le budget effets spéciaux étant davantage passé dans l’explosion finale du repaire du méchant et dans les quelques inserts, à l’instar de la tarentule montant sur l’épaule de Bond en milieu de film.
Dr. No est donc un film de son époque, un film d’enquête/d’aventure qui serait sans doute devenu assez anecdotique s’il n’avait pas été le premier volet d’une franchise qui vit toujours aujourd’hui, plus de 60 ans plus tard. Et les quelques coups de génie, ceux déjà cités ci-avant, mais également le thème musical composé par John Barry (abondamment utilisé, voire presque exclusivement utilisé dans ce premier opus), l’ingéniosité et la classe du personnage directement incarné par un Sean Connery animal, en font une entrée fracassante dans la légende. Bien sûr, le film est daté. Et certains tropes manquent encore, comme les voitures ou les gadgets, mais on a définitivement un James Bond devant les yeux. Réac, violent, presque colonialiste, comme l’état la société d’alors et comme le souhaitait certainement Ian Flemming. L’œuvre d’une époque, à redécouvrir pour entrer dans la légende.
PS : détail amusant, Terence Young, le réalisateur, signera quelques années plus tard le scénario d’un … OSS 117 ! Plus étrange encore, sur le tard, il a accepté de produire et de réaliser en partie une commande de téléfilm pour Saddam Hussein. Comme quoi, l’Histoire, ici dans deux réalités très différentes, est ironique presque par principe.
James Bond will return.
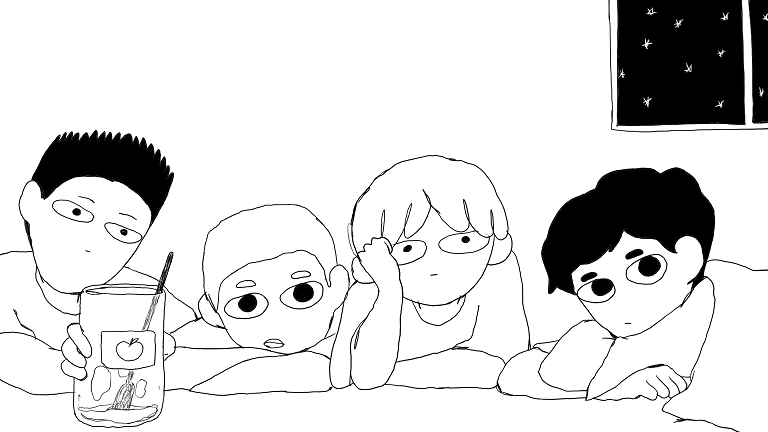 D’Emilie Tronche, 2024.
D’Emilie Tronche, 2024.
 De
De  De Terence Young, 1963.
De Terence Young, 1963. De
De