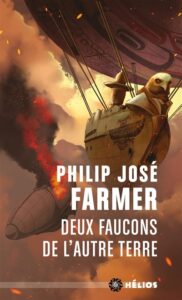 De Philip José Farmer, 1979.
De Philip José Farmer, 1979.
Publié une première fois sous le nom de La Porte du temps en 1983, traduit de The Gate of Time, daté de 1966, Deux Faucons de l’autre Terre est en fait la traduction, cette fois-ci complète, de la version mise à jour par l’auteur du roman Two Hawks from Earth de 1979. Bref, oubliez les aléas des révisions et des traductions, la version poche sortie chez Hélios en 2021 est bien la version définitive de cette uchronie classique, telle qu’imaginée par son auteur, Philip José Farmer. Et ce dernier est l’un des derniers grands auteurs classiques, aux côtés d’Asimov et de C. Clarke dont nous n’avons pas parlé en ces colonnes. Encore faut-il préciser que José Farmer, comme C. Clarke en fait, a traversé les époques, passant allègrement de la SF américaine de l’âge d’or des années 50 à la SF plus mature, inquiétante et désespérée des années 70. Né à la fin de la première guerre mondiale, il a débuté comme le veut la forme d’alors par des nouvelles dans les années 50 avant de verser dans le roman à partir des années 60 et jusqu’aux années 90 (il est décédé à la fin des années 2000). Entre les deux, il aura livré deux grandes sagas de SF qui sont aujourd’hui considéré comme des classiques : la Saga des Hommes-Dieux (7 romans) et le Fleuve de l’éternité (5 romans), que je n’ai pas lu jusqu’à maintenant et ne peut donc commenter intelligemment.
Deux Faucons de l’autre Terre est donc un roman appartenant à la deuxième carrière de l’auteur, après qu’il se soit détaché des tropes de la SF positiviste des années 50, marquée par des histoires simples et des peurs identifiées, pour verser déjà dans un anticipation moins dichotomique, davantage inspirée par les réalités sociales changeantes de la seconde moitié des années 60 et le début de la désillusion américaine avec, notamment l’enlisement au Vietnam ou sur les autres fronts de la Guerre froide, qui inspirèrent sans doute les quelques révisions et ajouts apportés à l’auteur dans le roman à la toute fin des années 70.
Pour faire simple, le roman débute par l’arrivée d’un journaliste dans le nord de l’Europe pour interviewer un dénommé Roger Two-Hawks (étrange de la part du traducteur d’avoir traduit le nome du protagoniste dans le titre du roman et non dans le corps du texte, mais soit), célébrité de la dernière guerre mondiale, avant son départ vers une nouvelle aventure. A Two-Hawks de raconter alors son histoire, qui occuper la majeure partie des 350 pages du bouquin. Et celle-ci débute alors que ledit Two-Hawks est pilote d’un avion allié, prêt à bombarder une base arrière logistique du IIIème Reich quelque part en Roumanie avant de se faire abattre par un avion allemand en ayant eu le temps de le toucher également. Seulement, Two-Hawks et l’unique autre survivant de leur bombardier se rendent assez vite compte que quelque chose cloche : le Roumanie dans laquelle ils étaient sensé s’être abîmés n’est pas tout à fait celle à laquelle ils s’attendaient…
Les habitués de la SF auront rapidement compris que les protagonistes (Two-Hawks, son second et le pilote allemand) sont passés par une porte dimensionnelle pour arriver sur une Terre parallèle, découvrant ainsi petit à petit une société uchronique en même temps proche et très éloignée de la Terre que l’on connait. En effet, sur cette autre Terre, le continent américain n’a jamais émergé des eaux de l’Atlantique/du Pacifique (eh oui ! s’il n’y a pas de continent américain, il n’y a pas de démarcation entre les deux grands océans terrestres !), avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la biodiversité (pas de café, pas de chocolat, pas de patates !), sur la géophysique (pas de gulf stream, la Grande-Bretagne ayant donc un climat quasi-arctique) et sur les grands mouvements de population. Et c’est ce dernier point en particulier qui fait tout le sel du roman : les amérindiens existent bel et bien sur cette Terre parallèle, mais ils se sont installés au gré des migrations historiques en Europe centrale. Les suomis ne sont pas en Finlande, mais au Japon. Les celtes sont restés en grandes-bretagnes alors que les angles ont disparu. Plus étrange encore, c’est une Terre où la population arabe existe, mais ou les noirs africains n’existent pas. Et Two-Hawks, étant lui-même iroquois et s’étant servi de l’armée américaine comme chausse-pied social, se retrouve donc dans une position inédite pour lui. Son peuple existe mais ne le reconnait pas (les langues ont évolué différemment : au début du roman, personne ne se comprend). Il est détenteur d’un savoir technologique avancé (en effet, sur la Terre parallèle, pas de caoutchouc, donc pas de roue souple sur les engins de guerre ! et une maîtrise amoindrie des technologies fait que les Allemands locaux en sont restés au zeppelin, alors que Two-Hawks est pilote de chasseur !) et devient donc rapidement un asset de guerre important pour les différentes nations qui se déchirent en Europe continentale (ça, ça reste valable sur cette Terre parallèle, malheureusement).
Et le roman de suivre Two-Hawks dans ses pérégrinations et ses dilemmes moraux, qui le feront passer d’un camp à l’autre, forcé parfois par le pilote allemand qui n’a pas temps de scrupule. Jusqu’à la révélation finale [SPOILER] qu’on sent quand même venir assez vite : Two-Hawks lui-même ne vient pas de la même Terre que le pilote nazi. Si ce dernier vient bien de l’Allemagne des années 40 que l’on connait sur notre Terre, Two-Hawks vient lui d’une autre Terre, assez similaire à la nôtre, mais où la seconde guerre mondiale oppose toujours l’austro-hongrie au reste du monde et non l’Allemagne du troisième Reich. [/SPOILER]. Le livre de se conclure alors sur une tentative de la part de Two-Hawks de retourner chez lui à travers un autre portail dimensionnel reliant les diverses Terres avec un retournement final que je ne vais pas vous dévoiler ici afin de vous préserver le plaisir de lecture.
Mais que vaut le bouquin, pour finir ? Et bien je suis assez mitigé après l’avoir terminé il y a déjà quelques jours. Si le roman est bien écrit, érudit et haletant, il y a néanmoins quelques longueurs où José Farmer nous expose à répétition les différences qui existent entre les deux Terres concernées, les trajets de l’un ou l’autre groupe ethnique. Evidemment, cela s’explique par le fait qu’aucun des noms des pays ou des peuplades européennes n’est similaire dans le roman, ce qui force le lecteur à un jeu mental pour essayer de resitué les « nouvelles » nations sur une carte relativement similaire à la nôtre (je dis relativement puisque, par exemple, au-delà du fait que le continent américain n’a jamais émergé des eaux, à l’exception de quelques iles constituées par les sommets des rocheuses, l’Inde, par exemple, s’est bien détachée de l’Afrique mais sans aller s’encastrer dans le continent eurasiatique, nous privant par exemple de la chaine de l’Himalaya et de la civilisation tibétaine). Mais ces explications à répétition sont parfois un peu laborieuses.
De même, et même si je comprends que le récit l’exige, il y a tout de même une grande facilité scénaristique qui me dérange un peu : notre protagoniste principal, Roger Two-Hawks, de la nation iroquoise de sa Terre d’origine, ne mets que quelques semaines à apprendre les différents idiomes pratiqués sur la Terre parallèle sur laquelle il débarque. Le prétexte qu’il soit diplômé en linguistique et qu’il connaisse plusieurs dialectes des premières nations américaines alors même qu’il tombe dans le lieu européen où ses bassins linguistiques ont évolué me semble assez gros comme ficelle. Par ailleurs, si le propos du livre, notamment à travers sa réflexion sur les discriminations, sur les identités communautaires, et même à travers ses penchants féministes, est résolument moderne, son personnage principal est bizarrement à contre-courant. Il ressemble bien davantage à un dandy intellectuel du XIXème (alors qu’il souffre de discrimination raciale sur sa Terre d’origine, rappelons-le !) qu’au pilote de l’armée de l’air américaine qu’il est censé être. Bref, il y a un certain déséquilibre entre le propos et les personnages qui le portent, déséquilibre que Philip José Farmer semble vouloir nier ou négliger. Cela fait de Deux Faucons de l’autre Terre un agréable roman d’aventure, une uchronie intelligente et assez différente de celle qu’on a l’habitude de lire par ses modifications géologiques et de migration des peuples, mais ça en fait aussi un roman parfois un peu bancal qui souffre de scories qui se veulent érudites mais qui sont parfois mal amenées. A vous de voir si vous tentez l’aventure.

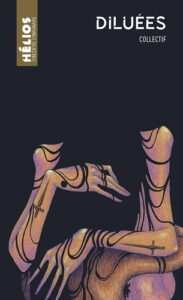
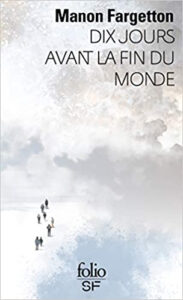 De
De  De Zack Snyder, 2024.
De Zack Snyder, 2024. De
De