 Edité par Zoé Laboret, 2022.
Edité par Zoé Laboret, 2022.
Figure relativement discrète de l’édition de littérature SFFF francophone depuis quelques années, Zoé Lahoret semble très fière d’avoir été choisir par les éditions ActuSF en 2022 pour éditer ce court recueil de nouvelles à la manière d’un cadavre exquis. C’est du moins ce qu’elle laisse entendre dans le très court avant-propos qui précède les textes en eux-mêmes. Sept nouvelles se succèdent ensuite, qui ont pour point commun, comme l’indique la quatrième de couverture, de mettre en scène de l’érotisme queer. Sept nouvelles de septs auteurs et autrices dont je n’avais, jusque-là, jamais entendu parlé.
La première, Ereshkigal, signée de Morgane Stankiewiez, nous emmène dans un futur indéterminé, sur une lune terraformée dans une ambiance à la Cyberpunk (l’excellent jeux polonais des créateurs de The Witcher). L’autrice a une bonne vingtaine de romans à son actif, mais je n’en connais aucun. On y découvre une chanteuse punk dépressive, enfermée dans la cage dorée d’une compagne qui ne l’aime plus pour qui elle est mais pour l’histoire de rédemption qu’elle s’est attribuée. C’est sans compter sur un I.A. rebelle, qui par le corps et par la tête va lui rappeler qui elle est vraiment. L’ambiance est très aimable, mais le développement sans doute un peu simple, même si on note l’effort d’aller chercher un cadre mythologique sans doute moins courru que les poncifs habituels.
Couleur d’écume, de Morgan of Glencoe, est la deuxième nouvelle du recueil. Changement radical de décors pour présenter les amours saphiques d’une capitaine pirate au grand cœur qui tombe littéralement en adoration devant une petite rouquine irlandaise dans un décors de mer des caraïbes. Bien écrit, si l’on aime le vocabulaire marin, mais très fleur bleue. Rien qui m’a donné envie de découvrir les multiples romans que l’autrice et musicienne a apparemment publié chez ActuSF. La troisième nouvelle, Vœux électriques, de Karine Rennberg, nous plonge quant à elle dans le Paris de l’expo universelle. On retrouve deux protagonistes, à nouveau deux femmes, qui ont comme point commun de ne pas être comme les autres. L’une veut accéder à la connaissance dans un monde où celle-ci est réservée aux hommes, l’autre, riche veuve, a des goûts qui ne sont pas ceux de son temps. La fée électricité va cependant les aider à trouver une voie commune. Mignon, à nouveau, sans éclat.
On poursuit avec Bouches d’incendie, de Cordélia, qui se déroule dans une France contemporaine. Un jeune homme timide, ayant terminé récemment sa transition, rencontre sur le pavé d’une manifestation anti-nucléaire une jeune journaliste androgyne. Et c’est le coup de foudre. A nouveau, bizarrement très convenu. Vieilles connaissances, de Nadège Da Rocha, nous plonge quant à elle dans un univers médiéval où une chevaleresse sur le retour s’embarque dans une dernière aventure avec une jeune page un peu niaise avant de tomber, lors d’une chasse au dragon improvisée, sur une vieille amie et se rappeler, ainsi, de tendres souvenirs de jeunesse. Davantage maîtrisé, drôle par moment, nostalgique, la plume de Nadège Da Rocha m’a fait penser par moment aux textes plus courts de Robin Hobb. Et c’est un compliment. Le plus beau texte du recueil à mes yeux, sans doute en raison de son cadre de fantasy plus marqué.
Alpha Beauty, de Théodore Koshka, est sans doute le texte qui m’a le moins plus. Pourtant, l’idée de raconter un crime par la victime dans un futur indéterminé très marqué par une division de l’humanité en classes (les alphas, les bétas et les omégas) est une bonne idée sur le papier. Le fait que des traumatismes anciens et des non-dits émaillent le récit est aussi bien pensé. Mais le tout est gâché par un développement relativement minimaliste et par un choix assumé d’éviter les terminaisons genrées par un système d’écriture complexe lié à la classe et non au sexe/au genre. A part alourdir la graphie et parasiter la fluidité du texte, cela n’apporte en plus rien qu’un accord classique de genre n’aurait apporté également au texte. Soit. Enfin, le recueil se termine sur la nouvelle Comme un soleil, de J. M. Corrèze, un texte plus contemplatif qui nous parle des multiples vies d’une divinité mineure du feu qui, au fil des générations, s’incarne de diverses manières pour aimer des représentants et représentantes de « son » peuple. Original, poétique et doux. C’est clairement le deuxième point fort du recueil.
L’un dans l’autre, ce recueil, qui se veut une publication qui change le regard sur le genre et la littérature queer en général, est plutôt raté. Pour plusieurs raisons. D’abord, je crois comprendre que l’idée étaient que les textes forment un tout, sur le principe du cadavre exquis, chaque auteur et autrice élaborant son histoire à la suite du précédent. Pourtant, les liens sont extrêmement ténus (si l’on oublie les deux impératifs éditoriaux : de l’érotisme et des amours queers). Au-delà de quelques redondances de noms, seule la peur de l’eau revient comme thématique commune, embarquée d’histoire en histoire sous diverses formes et avec diverses conséquences. C’est un peu maigre, comme cadavre exquis : cela ressemble davantage à une contrainte éditoriale supplémentaire qu’à un vrai exercice de rédaction à multiples mains. Mais soit, c’est assez mineur comme soucis.
Non, mon principal problème est que l’ensemble est finalement très gentillet. Bien que l’on parle d’amours queer, il faut déjà noter d’emblée que cinq des sept nouvelles présentent uniquement des couples lesbiens. Je n’ai rien contre, mais c’est assez réducteur par rapport à la polyphonie des amours divers sont l’éditrice se vente pourtant dans son avant-propos. Et c’est extrêmement fleur bleue. La majorité de ces histoires se finissent bien pour leurs protagonistes principales, à la limite du « et iels vécurent heureux.ses jusqu’à la fin des temps« . Pas très subversif, comme message. Ni très réaliste : aucune d’entre elles n’a l’air de vraiment être victime de la société qui les entoure, de préjugés ou de difficultés particulières liées à leur sexualité ou à leur genre, alors que c’est pourtant bien le ressort scénaristique (et la trise réalité) le plus simple à mettre en œuvre.
Comme si cette sexualité différente (dans le sens différente de la majorité hétéro), pourtant l’objet principal des nouvelles, n’était en fait en rien un élément scénaristique. Je peux comprendre la démarche, souhaitant normaliser au maximum les pratiques sexuelles diverses, ne pas en faire un élément déclencheur ou un obstacle dans la dramaturgie interne du texte, mais alors pourquoi le mettre en avant comme un argument de vente du recueil ? De même, les scènes de cul (c’est plus tellement de l’érotisme, quand c’est explicite, les ami.e.s…), pour amusantes qu’elles soient à lire, sont aussi finalement très sages. Poppy Z. Brite, que j’avais commenté ici il y a quelques temps déjà, était nettement plus subversive sur le sujet il y a plus de 30 ans. Comme si l’érotisme queer (saphique, surtout) était complètement aseptisé pour donner une succession de saynètes gentillettes, dans un cadre SFFF qui fait vendre. Honnêtement, ça m’a rappelé les publications yaoi qui fascinaient les jeunes filles en manque de sensations fortes fin des années 90. Des bluettes soi-disant transgressives qui répondent davantage aux codes de la bit-lit que d’une véritable écriture engagée. Une belle déception, donc.

 De
De 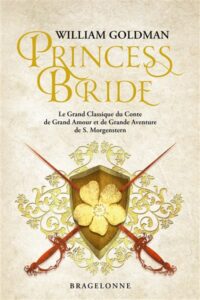 De
De 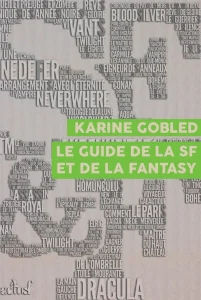 De
De  Edité par
Edité par