 D’Amélie Nothomb, 2021.
D’Amélie Nothomb, 2021.
Comme chaque année, en août, vient le temps de chroniquer le nouveau Nothomb. Et la vendange précoce est plutôt bonne, en 2021. Nothomb nous habitue depuis des années maintenant à alterner entre les textes de fiction pure et les textes (plus ou moins) autobiographique. Celui-ci est à ranger parmi les derniers. Elle n’y parle cependant pas d’elle, mais bien de son père, Patrick Nothomb, baron et diplomate, qui fut longtemps en poste en Asie, ce qui explique la jeunesse chinoise et japonaise de l’auteure à chapeau. Et l’on apprendra dans cet opus que son premier poste, à l’orée des années 60, était au tout jeune Congo indépendant d’alors et que l’affectation ne fut pas de tout repos.
Alors que le roman s’ouvre sur son père dans la vingtaine, en poste dans l’ancienne colonie belge, face à un peloton d’exécution composé de rebelles indépendantistes de l’Est du pays (60 ans plus tard, les choses n’ont pas réellement changé, doit-on amèrement constater), Nothomb digresse bien vite sur la jeunesse de son père. Elle nous sert alors la trajectoire de vie, sans doute largement fantasmagorique et exagérée, de son géniteur. Pas de prénom étrange cette fois-ci, mais bien une famille désaxée, où la mère (et grand-mère d’Amélie), veuve trop jeune, n’a que peu d’amour à offrir à ce fils délicat et intellectuel, qu’elle confiera à ses propres parents pour mener une vie dans le gotha belge de l’époque.
De constitution fragile et entouré essentiellement par des femmes, le petit Patrick est, selon son grand-père maternel, colonel à la retraite de l’armée belge, peu armé pour affronter la vie. On l’enverra alors pendant les mois d’été apprendre la vie à la dure dans le château du grand-père paternel, le baron Nothomb qui erre, un peu perdu dans ces premières décennies du XXème siècle, dans son château décrépit de la campagne luxembourgeoise (la province belge, pas le Grand-Duché). L’homme en question, poète raté, est à la tête d’une famille nombreuse où les enfants plus jeunes sont laissés plus ou moins à l’abandon, devant se débrouillé pour survivre jusqu’à l’âge adulte malgré les assiettes souvent vides et le confort inexistant. De ces vacances d’été et d’hivers, le jeune Patrick apprendra la vie en communauté, le sentiment de faire partie d’une bande et, surtout, l’instinct de survie, qui sera la clé du reste de sa vie.
Et Nothomb d’enchaîner avec la suite de la vie de son père, de manière plus brève mais toujours décalée avant de rattraper le présent et d’offrir dans les derniers chapitre la conclusion de la situation tendue qui ouvrait le roman. Impossible de dire, à la lecture de Premier sang, ce qui relève de l’histoire et ce qui relève de la licence poétique (dont l’arrière-grand-père d’Amélie usait et abusait comme cache-misère, visiblement, malgré la fascination qu’il exerçait chez ses interlocuteurs). Mais qu’importe. Le style Nothomb, la mécanique de ses portrait sociaux de personnage hors norme et ses diverses obsessions nourrissent à merveille ce portrait qui se veut plus intimiste, moins moralisateur et sans doute plus franc que ses œuvres plus romanesques. Il y a, en effet, une sorte de proximité qui s’installe entre le lecteur et les personnages, proximité plus grande que dans ses récits de fiction, qui rend l’ensemble plus touchant, plus vivant, plus humain.
Si je regrettais l’année passée qu’elle n’ait pas creuser davantage la veine de Soif, qui la faisait davantage sortir de ses sentiers battus, je ne peux qu’avouer être séduit par ce retour aux affaires qui rapproche ce Premier sang d’un Journal d’hirondelle ou de Ni d’Eve ni d’Adam. Une bonne cuvée, malgré les vendanges précoces habituelles pour Amélie Nothomb qui aime à ouvrir la rentrée littéraire avec sa courte fulgurance, comme chaque année depuis 30 ans maintenant.

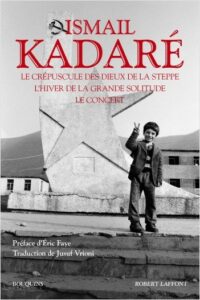 D’
D’ De
De  De
De  D’
D’