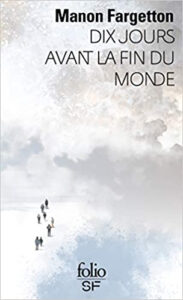 De Manon Fargetton, 2018.
De Manon Fargetton, 2018.
Surtout connue dans le petit monde de la littérature de genre pour Les Illusions de Sav-Loar, sorti il y a quelques années chez Bragelonne, Manon Fargetton est une autrice active depuis déjà pas mal d’années dans des genres différents (fantasy, SF, tranche de vie, etc.) Surtout active dans la littérature jeunesse et adolescente, ce Dix jours avant la fin du monde semble trancher un peu de sa production habituelle, même si le roman fut dans un premier temps publié chez Gallimard Jeunesse. Choix assez étrange, tant les thématiques traitées par le roman s’éloignent un peu des canons du genre. Je peux cependant saisir que le bouquin vise un public d’ados, pour plusieurs raisons qu’on va développer ci-après. J’ai pour ma part lu le livre chez Folio SF, collection à laquelle je reste assez fidèle depuis ces débuts en l’an 2000 et dont je suis rarement déçu des choix éditoriaux. Ce n’est pas la première fois qu’ils republient dans une collection « adultes » des romans destinés initialement à la jeunesse (l’excellente trilogie A la croisée des mondes, de Philip Pullman, la moins inspirée mais agréable trilogie du Chaos en marche, de Partick Ness, etc.), mais ce n’est pas la raison qui me l’a fait sortir de ma PAL. La raison est assez simple : ça fait longtemps que je n’avais plus lu de postapocalyptique français.
Enfin, postapocalyptique, ce n’est pas tout à fait vrai. Comme le titre le laisse entendre, on est davantage dans du « pré-apocalyptique« , pour autant que la locution existe bel et bien. En résumé, dès l’entame du roman, la Terre se retrouve à saisir des fronts d’explosions, dont la provenance n’est jamais expliquée ni justifiée qui annihilent toute vie sur son passage. Ces explosions, débutant quelque part en Extrême-Orient (voir dans le Pacifique), progressent comme des vagues tant vers l’Est que vers l’Ouest. Leur point de rencontre se situe quelque part sur la côte atlantique européenne, à quelques miles marins des rivages normands et bretons. Ce déclencheur narratif nous est conté à travers le point de vue d’une demi-douzaine de personnages qui, au départ du roman, n’ont que des liens distants, quand ils en ont (deux sont voisins, d’autres sont collègues, un chauffeur de taxi vient s’ajouter, etc.) Tout ce petit monde, après le choc initial, va décider de tenter de survivre le plus longtemps possible en se dirigeant depuis Paris vers la côte en question, dans un contexte où la civilisation s’écroule petit à petit autours d’eux (fin des télécommunications, approvisionnement en eau, en nourriture, en carburant, etc.) Après un rapide calcul, ils arrivent à la conclusion qu’ils ont dix jours devant eux. Dix jours avant la fin du monde.
Sous le prétexte de cette apocalypse imminente, les différents protagonistes vont se dévoiler au fil des pages, essayant de résoudre les conflits intérieurs qui les occupent, de faire la paix avec leurs proches (s’ils sont encore vivants) et, surtout, avec eux-mêmes. Je ne pense pas utile de développer davantage l’intrigue ni les différents protagonistes dans ce court résumé, pour vous préserver des spoilers mais, surtout… parce que la personnalité des uns et des autres devient déjà un peu brumeuse dans ma tête, malgré le fait que je n’ai fini le livre qu’il y a quelques jours. C’est un peu le problème du bouquin à mes yeux : si l’autrice a tenté de donner des personnalités et des blessures intimes différentes à chacun de ses protagonistes, je ne peux pas m’empêcher de les confondre les uns avec les autres. Est-ce la paresse intellectuelle de ma part ? Peut-être. Ou est-ce simplement le fait que ces blessures intimes et ces trajectoires individuelles sonnent davantage comme des atermoiements adolescents qu’à de vrais préoccupations d’adultes qui seraient confrontés à pareille situation. Je ne peux m’empêcher de penser à ces séries pour ados produites à la chaîne par Netflix et consorts. Si les thématiques sont sérieuses (le viol, le deuil, le déracinement, etc.), elles sont traitées de manière tellement convenue que les émotions qu’elles provoquent sont finalement interchangeables.
Le bouquin m’est d’ailleurs un peu tombé des mains dans son deuxième acte. La premier acte, l’élément déclencheur, est traité avec suffisamment de subtilité pour provoquer l’intérêt et lorsque les protagonistes entrent en scène, leurs traumas sont encore inconnus et ils ne sont donc pas encore réduits à leurs fonctions narratives. Le dernier acte, la résolution, si elle est par moment convenue, est suffisamment soutenue par un crescendo scénaristique que pour tenir en haleine le lecteur. C’est le ventre mou du bouquin, les 200 pages de développement après le premier acte, correspondant grossièrement au voyage des protagonistes vers l’Ouest et leur installation sur la côte atlantique française, qui m’ont fait sortir de l’intrigue. Peut-être suis-je trop vieux pour trouver un intérêt dans ces développements individuels simplistes, ou peut-être suis-je lassé d’un cahier des charges des messages « humanistes » de la littérature ado auquel Manon Fargetton répond parfaitement. Le bouquin a du coup peu d’aspérités, peu de fulgurances qui en feront une lecture inoubliable. Sans doute l’avis d’un jeune lecteur ou d’une jeune lectrice qui serait ici confronté à son premier bouquin de SF apocalyptique serait différent et plus enthousiaste. Pour le vieux renard que je suis, les ficelles sont un peu grosses et les surprises trop peu présentes pour en faire une lecture réellement digne d’intérêt. La plume de Fargetton est cependant agréable et elle a quelques bonnes idées : le récit dans le récit, par exemple, né d’un personnage écrivain qui trouve son inspiration, presque surnaturellement, dans ces évènements cataclysmiques, offre une parenthèse bienvenue dans le récit linéaire des évènements. Je réserve donc mon avis sur Manon Fargetton comme écrivaine et regrette simplement d’avoir fait sa connaissance à travers un roman trop convenu pour être réellement intéressant.

 De
De  De Zack Snyder, 2024.
De Zack Snyder, 2024. De
De  De
De