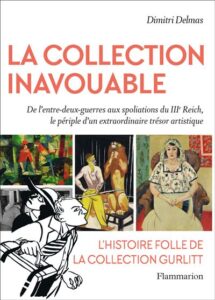 De Dimitri Delmas, 2023.
De Dimitri Delmas, 2023.
Sous-titré : De l’entre-deux-guerres aux spoliations du IIIe Reich, le périple d’un extraordinaire trésor artistique – L’histoire folle de la collection Gurlitt
Lorsque Cornélius Gurlitt, au cœur de l’hivers 2012, est contrôlé par la douane suisse dans un train, personne ne se doute qu’on trouvera quelques jours plus tard dans son appartement munichois des centaines de chefs d’œuvres réputés disparus depuis la seconde guerre mondiale : des Renoir, Cézanne, Courbet, Chagall, Picasso, Delacroix, Munch ou encore des dessins, aquarelles et peintures de la scène nouvelle allemande de l’entre-deux-guerres, George Grosz ou Otto Dix en tête. Cette histoire rocambolesque met un terme à l’histoire d’une collection cachée, rassemblée par Hildebrand Gurlitt, marchant d’art allemand qui rassembla, dans des conditions allant du discutable au criminel, une véritable collection d’art « dégénéré« , pour reprendre le vocable nazi, pour son profit personnel.
Dimitri Delmas choisi de nous conter cette histoire comme un roman familial, recadrant au fil des chapitres les grands épisodes de l’histoire de l’art des premières décennies du XXème siècle et de la montée du national-socialisme. L’auteur n’étant pas un spécialiste de l’histoire de l’art, étant davantage illustrateur qu’académicien, il nous raconte l’histoire plus qu’il ne la documente. Cela fait de cette Collection inavouable un récit plutôt qu’un essai. Soutenu par ailleurs par les illustrations fort à propos (quelques planches de BD, quelques portraits, quelques illustrations savamment distillées au fil de l’ouvrage) par Laureline Mattiussi et Delmas lui-même, le bouquin, malgré son épaisseur, se lit en quelques heures seulement. Brassant large, de courts portraits de l’avant-garde allemande des années 20 jusqu’à la présentation du travail des « Monuments Men » de 1945 à 1950, Delmas a l’intelligence de développer son récit comme une fiction au cours de laquelle, d’épisode en épisode, le lecteur assiste à la lente dégradation morale d’un homme, Hildebrand Gurlitt, d’ascendance partiellement juive, combattant pour l’Allemagne en 14-18, grand amateur d’art moderne au tournant du siècle et licencié de deux fonctions successives pour cela par le régime nazi, qui finira par devenir l’un des grands receleurs d’art du troisième Reich, manœuvrant dans l’ombre pour enrichir sa collection et ses deniers personnels.
En filigrane, on découvre également la vie de son fils, le Cornélius contrôlé par la douane, qui vécut toute sa vie reclus, entouré de ses œuvres maudites qui l’empêchèrent d’avoir une vie « normale« , dans l’ombre de la folie de son défunt père. Un roman du siècle, en somme, de la lumière à l’ombre. Quand l’affaire est sortie dans les médias en 2014, après deux ans d’enquête par les polices allemandes, suisses et autrichiennes, elle fit grand bruit dans le monde muséal et dans le monde artistique en général. L’ampleur de la collection a déchaîné les passions et les fantasmes, parlant d’une collection de plus d’un milliard d’euros. Cornélius Gurlitt étant décédé avant d’être confronté aux conséquences des crimes de son père, il choisit de léguer sa collection, à défaut d’hériter, au musée d’art de Berne. Et de là est né un regain d’intérêt, essentiellement européen, dans la recherche de provenances de biens spoliés pendant la seconde guerre mondiale, plus de quinze ans après la convention de la Washington et de la première vague de travail d’historiens et de mémoire réalisé, parfois timidement, par les grands musées de beaux-arts d’Europe de l’Ouest (et des Etats-Unis).
C’est en effet cet affaire retentissante, résumée avec brio par Dimitri Delmas, qui a remis un coup d’éclairage sur ces pièces que l’on considérait perdues à jamais, rouvrant le débat parfois compliqué des collections privées ou publiques qui se constituèrent sur le malheur des uns et le bonheur des autres. La boussole morale, évoluant avec les décennies, nous oblige à rouvrir certains dossiers, à se repencher sur certaines pistes, à approfondir nos connaissances pour un nécessaire devoir de mémoire. Et si d’aucuns craignent un début public à l’heure où l’antisémitisme regagne du terrain en raison des choix politiques extrêmes d’un gouvernement qui ne représente qu’une nation et non un peule, il n’en demeure pas moins qu’un tel débat est salvateur, ne fut-ce que pour s’épargner des œillères égoïstes qui ne se justifiaient que dans un contexte d’accumulation qui évoque la muséographie des temps passés. Merci, donc, à Dimitri Delmas d’avoir contribué par son roman d’un scandale, à la connaissance du grand public d’une page sombre de notre histoire collective. Et de l’avoir fait par le biais d’un essai historique qui se lit comme un bon roman à suspens, ce qui ne gâche rien, servit par une plume intelligente et des illustrations évocatrices. On lui pardonnera donc sans hésitation les quelques imprécisions et raccourcis qui s’imposent par la forme qu’il a choisi pour nous transmettre un récit humain, souvent médiocre et affligeant, mais désormais compréhensible.

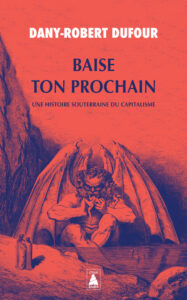 De
De 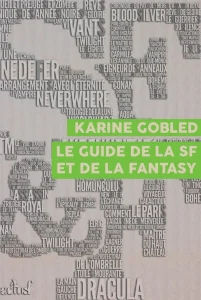 De
De 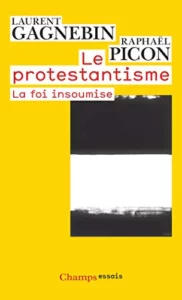 De
De 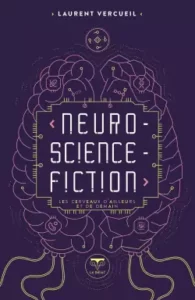 De
De