 De Zack Snyder, 2023.
De Zack Snyder, 2023.
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours défendu Zack Snyder. Depuis l’inénarrable 300 à Justice League (la Synder cut, off course), en passant par Watchmen, Man of Steel ou même Sucker Punch, il y a toujours quelque chose à sauver dans ses films. Si l’utilisation abusive des ralentis, si la coolitude volontaire de certaines scènes et si des personnages totalement over-the-top (Lex Luthor, on pense à toi) ne vous dérange pas, alors Snyder est le fantasme de tous les geeks : il a mis en image ses passions, toutes issues de la culture comics. Du coup, on était tous prêt à lui pardonner beaucoup de chose, même des adaptations spectaculaires mais qui ne rendent pas complètement justice aux œuvres de Frank Miller, d’Alan Moore ou aux multiples itérations de l’homme de Gotham.
Il s’était déjà laisser aller à réaliser un projet plus personnel, avec Sucker Punch, dont il était l’auteur principal du scénario (retravaillé ensuite avec Steve Shibuya). Le film, dont je parlerai peut-être un jour ici tant il m’avait marqué à l’époque, était lui aussi bancal : mais il y avait une certaine grandeur, une certaine aspiration qui se dégageait de l’ensemble. Une volonté de filmer une jeune asiatique dans un mécha rose bonbon qui flingue littéralement des nazis zombies dans des tranchées d’une imaginaire première guerre mondiale. Et de filmer ça le plus sérieusement du monde. Le tout servi par un casting impeccable (même si l’actrice principale en est ressortie traumatisée) et une bande son d’enfer.
Vous comprendrez dès lors mes attentes à l’annonce du premier volet d’un dyptique de science-fiction, produit par Netflix et basé sur un scénario original (chose de plus en plus rare dans le Hollywood actuel, exception faite des plates-formes de distribution). Et l’ampleur de ma déception. On sentait déjà avec Batman vs. Superman et The Justice League que le brave Snyder commençait à s’essouffler un peu, sans doute perdu face à l’ampleur de la tâche (vouloir adapter plusieurs séries de comics en même temps dans deux films syncrétiques relevait en effet de la gageure et perdait le spectateur en commettant le péché originel de toute adaptation : oublier qu’on a une histoire à raconter et des personnages à développer).
Le constat est amer : non seulement Snyder s’essouffle, mais il vraisemblable qu’il n’ait plus grand chose à offrir, si on en juge par ce premier volet de Rebel Moon. Je vous fais le résumé en quelques lignes : une jeune femme travaille la terre dans un petit village paysan de ce qui semble être une lune agricole d’une grande planète aux confins de la galaxie. Elle est effrayée lorsqu’elle voit débarquer au-dessus de son village d’adoption un vaisseau amiral du Monde-Mère (l’Empire, pour faire simple) à la recherche des rebelles qui ont assassiné l’ancien Roi de la galaxie. Ce dernier, apparemment belliqueux, est remplacé par un régent issu des rangs de l’armée et qui semble encore plus agressif. Lorsque les troupes du Monde-Mère débarque sur la charmante lune agricole, la situation s’envenime assez vite et la jeune réfugiée, Kora, se retrouve bien vite à mener… il faut bien le dire, une rébellion (si, si, je vous assure). Elle n’aura alors de cesse de chercher des alliés pour enfin ramener la paix dans la galaxie et la facilité pour son village d’adoption.
Heu… Comment dire… Star Wars, quelqu’un ? Enfin, le Star Wars de chez Wish. Car si j’ai bien un reproche à faire à ce film, c’est son côté cheap. Et c’est avec ça qu’on se rend compte que les plateformes de distribution, à l’instar ici de Netflix, n’ont pas les mêmes moyens que les grands studios américains et ne les auront sans doute jamais. D’où ces films au rabais. Je préfère vous prévenir ; je vais spoiler allègrement le film dans la suite de cet article, car, honnêtement, je vous déconseille de perdre deux heures de votre vie devant Rebel Moon et j’espère que ce texte aidera à vous en convaincre. La scène la plus emblématique de cet aspect fauché est pour moi la scène de résolution finale : alors que les dix gentils se sont fait arrêtés, il y a genre cinq pauvres soldats méchants qui traînent sur la rampe de lancement et qui échangent trois coups de pisto-lasers quand les gentils finissent, forcément, par s’échappé. Et du grand vaisseau amiral des méchants (le Star Destroyer du pauvre, encore une fois), on ne voit qu’une bête tourelle qui attaque les chasseurs des alliés des héros avant d’être la cause, par on ne sait quel truchement, de la destruction du Star Destroyer dans son ensemble. Et ça se finit par un duel sur une petite plateforme volante entre la gentille héroïne et le méchant du film (le second couteau du grand méchant qui sera évidemment là dans le deuxième volet) : un remake de la scène de fin de GoldenEye ou encore de Rogue One, mais avec moins d’intensité, moins d’éclat, moins d’enjeux et moins de brio. Snyder n’a même pas pu se résoudre à tuer le méchant de l’épisode, qui reviendra donc nous emmerder dans le second chapitre.
Et ce patchwork d’influences caractérise en fait tout le film : le groupe des héros récupère Djimon Honsou à côté d’un Colisée galactique tellement inspiré de Gladiator que cela en devient navrant (Djimon Honsou jouant dans Gladiator, pour rappel) ; Staz Nair joue un personnage à mi-chemin entre Conan et John Carter from Mars ; Bae-Doo Na joue un archétype de samouraï asiatique au grand cœur (avec sabre laser, s’il vous plaît !); Charlie Hunnam, laisser en roue libre, devient une caricature de ses rôles dans les Guy Ritchie malgré le fait qu’il essaie d’imiter Hans Solo, etc. etc.
Les quelques fulgurances du film, comme la scène d’intro de Némésis (Bae-Doo Na) où elle lutte contre une femme-araignée directement copiée sur le design de Lolth, la déesse drow des Royaumes-Oubliés, ou encore le retournement de situation quand on se rend compte que le personnage de Hunnam est en fait un méchant, sont bien vite gâchées. Ce qui pourrait passer pour de belles idées cache en fait des facilités d’écriture qui ne développent ni l’intrigue ni les personnages. La mort du personnage de Hunnam, qui intervient quelques secondes après la révélation de son retournement de veste, est parfaitement ridicule, pratiquement digne de la mort de Marion Cotillard dans The Dark Knight Returns…
Et je pourrais continuer les exemples à l’infini. L’essentiel est que ce patchwork d’influences, ce pot-pourri d’inspirations geeks oublie tout simplement d’avoir une histoire intéressante ou un quelconque développement de personnages. Les péripéties s’enchaînent sans vraiment de lien entre eux. Les quelques flashbacks sonnent creux. La collection de « héros » ne présente aucun lien entre eux et le spectateur est tout à fait en droit de se demander pourquoi ils se retrouvent embarquer dans la même histoire, au-delà d’un simple ressenti contre le Monde-mère.
C’est nul, voilà tout ce qu’il faut retenir. A la veille d’une année où les films attendus sont le deuxième Dune (la suite d’un remake), le nouveau Ghostbuster (la suite d’un reboot), Godzilla x Kong (la suite d’un reboot), Kingdom of the Planet of the Apes (le début de la deuxième trilogie d’un reboot) ou Mad-Max Furiosa (le prequel d’un reboot), on pouvait espérer quelque chose d’un scénario original, du début d’une nouvelle franchise. Les mauvaises langues diront qu’au moins on en a fini avec les Marvel à répétition, mais il n’en demeure pas moins que cela dit quelque chose sur le cinéma actuel : l’idée est de prendre le moins de risque possible, quoi qu’il arrive. Et même une plateforme qui n’a pas les mêmes impératifs, avec un grand réalisateur geek et un scénario inédit n’y arrivent pas : n’étant ni le remake, ni le reboot, ni la suite, ni le prequel de quelque chose, Rebel Moon réussi l’exploit de proposer encore moins que ces concurrents potentiels. Et la promesse d’un « Snyder-cut » ne peut pas sauver le bouzin : c’est devenu un gimmick commercial. Si un réalisateur n’est plus fichu de présenter la bonne version du premier coup, alors qu’il ne propose simplement pas cette première version. Il a perdu son mojo. L’ampleur présente dans ses échecs précédents, l’intention louable, est ici disparue. Reste un navet, même pas un nanard. Amis de la science-fiction intelligente, passez votre chemin : il n’y a rien à voir.

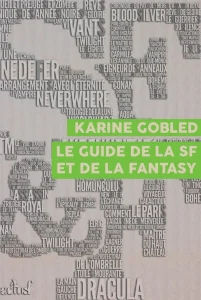 De
De  De
De 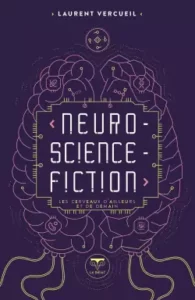 De
De 