 De Ben Aaronovitch, 2011.
De Ben Aaronovitch, 2011.
Moyennement convaincu par le premier opus du Dernier apprenti sorcier, la série phare de Ben Aaronovitch, mais ne souhaitant pas passer à côté d’une grande série si j’en crois le nombre de fans dithyrambiques qui peuple le web du livre, j’ai tenté l’expérience du deuxième tome quelques semaines après le premier. Et il y a clairement un mieux, même si le tout n’est pas exempt de scories.
On retrouve donc l’agent Grant, l’apprenti idoine de la série, et son mentor, l’inspecteur Nightingale, bien mal au point après la conclusion de la dernière enquête. Plus question ici des diverses rivières de Londres, mais d’une plongée dans le quartier bohème (et interlope, ça dépend du point de vue) de Soho au cœur de la capitale anglaise. Alors que des cadavres émasculés apparaissent ci et là (exploitant intelligemment les dernières lignes/pages des Rivières de Londres, qui faisaient du foreshadowing sur cette enquête sans qu’on y prête trop attention), Grant est également confronté à plusieurs morts suspectes dans le milieu du jazz. Des jazzmen dans la force de l’âge semblent en effet mourir de manière impromptue après avoir joué en live le titre Body & Soul sur l’une ou l’autre scène des petits clubs de jazz londoniens. Il n’en faut pas plus à Grant, dont le père est une légende malheureuse du jazz, passée à côté de sa carrière en raison d’addictions un peu trop addictives, pour se sentir concerné et se lancer dans une enquête qui mêle considérations policières et supputations magiques diverses.
Si, en plus, Grant peut en profiter pour charmer une femme gironde et accueillante, ex-maîtresse de l’un des jazzmen récemment décédé, il en profitera certainement pour joindre l’utile à l’agréable (on se rappellera que son précédent « crush » a malheureusement eu le visage détruit par un hôte fantomatique psychotique dans le premier tome, ce qui ne facilite pas une vie amoureuse apaisée…) Les problèmes surgissent évidemment quand les enquêtes finissent par se croiser et que les cadavres s’accumulent…
L’avantage d’un deuxième tome par rapport à un premier est que l’on perd évidemment moins de temps à installer les protagonistes. Ce tome-ci s’intéresse donc, peut-être encore davantage que le précédent, à l’agent Grant. Il y a en effet peu de place pour les autres protagonistes, même si l’on en apprend davantage, et de manière parfois détournée, sur Nightingale, l’inspecteur Stephanopoulos, sur le docteur et médecin légiste Wallid, sur la collègue de Grant, Lesley (pourtant largement absente dans ce tome-ci) et sur Molly, la femme d’ouvrage/vampire résidente du QG de nos héroïques policiers du paranormal. C’est donc Grant qui sera le moteur du roman, naviguant entre ses erreurs et ses réactions parfois naïves sur ce monde nouveau qui l’entoure. Et c’est tant mieux, car l’identification est plus grande dans ce deuxième opus, amenant du coup avec lui un plus grand intérêt dans le récit.
L’enquête en elle-même, plus sombre, plus « policière » que la première, est également plus prenante. Elle obéit davantage aux codes du genre et l’ambiance jazzy et enfumée qui s’en dégage nous transporte presque davantage à la Nouvelle Orléans que dans les bas-fonds de Londres. L’important est cependant qu’elle nous transporte en effet ; on vit l’ambiance des rues de Soho, de pubs en boîtes de nuit, de planques enfumées en garçonnières fort à propos (ce tome est PG13, sans doute, puisque Grant vit ses pulsions, cette fois-ci). Sans dévoiler l’intrigue, on a donc un roman plus intéressant, davantage maîtrisé, qui dévoile ce qu’il faut de lore supplémentaire pour construire les épisodes qui suivront immanquablement. Qui plus est [SPOILER, même si mineur], ce second tome introduit assez logiquement le « grand méchant« , le sorcier noir qui sera le parangon de nos héros pour au minimum les quelques prochains tomes. C’est évidemment malin, pour tenir le lecteur en haleine [/SPOILER]. Le bouquin est également plus sinistre, par bien des aspects, ce qui renforce aussi le côté « hard-boil » polar que Aaronovitch semble vouloir mettre en place, sans pour autant oublier quelques touches d’humour, essentiellement noir, bien sûr, qui viennent alléger l’ensemble et conserve habillement l’humanité des protagonistes.
Cependant, comme je le disais, le bouquin n’est pas exempt de défauts. La conclusion est toujours un peu bordélique, comme dans le premier tome, et manque assez singulièrement de maîtrise. Si les diverses enquêtes se rejoignent, comme dans tous les bons policiers, les liens sont franchement ténus entre les fils du récit et les motivations du « grand méchant » franchement obscures. Du coup, on ne saisit pas bien en quoi l’intrigue des jazzmen et les créatures qu’elle contient a réellement comme intérêt pour l’intrigue des chimères et magicien sans-visage. Par ailleurs, pour sensible que l’on peut être vis-à-vis de l’idéalisme de Grant, on ne peut que rester dubitatif devant son raisonnement visant à protéger son « intérêt » (difficile d’être clair sans spoiler). Du coup, la fin, pourtant davantage maîtrisée que celle du premier tome notamment par quelques scènes d’exposition finales, reste le point faible du bouquin, ce qui est évidemment dommage.
L’un dans l’autre, ce deuxième tome est cependant une réussite. Aaronovitch y maîtrise mieux l’ambiance et le style nécessaire au type d’histoire qu’il compte écrire. Son récit est davantage construit et ses personnages ont davantage d’épaisseur, alors que le protagoniste principal occupe presque à lui seul le devant de la scène. Et c’est une bonne surprise, qui augure le meilleur pour la suite de la série et qui éclaire davantage à mes yeux la presse très positive dont le Dernier apprenti sorcier bénéficie depuis plus d’une décennie maintenant.

 De
De 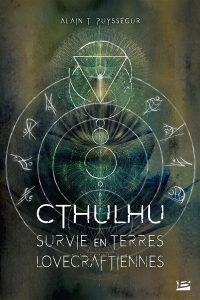 D’
D’ De
De  De
De