 De Kij Johnson, 2016.
De Kij Johnson, 2016.
Dans la longue tradition de ce blog d’arriver après la guerre, nous allons parler aujourd’hui de La quête onirique de Vellitt Boe, que toute la blogosphère SFFF a déjà chroniqué il y a deux ans quand le bouquin était sorti en grand format chez Bélial’ (le monde est petit). Et, une fois encore, nous allons parler de Lovecraft (qui, décidément, a beaucoup occupé mes lectures cette années, de manière souvent détournée, inspirée ou inspirante). Kij Johnson est une romancière américaine connue en francophonie surtout pour sa nouvella Un pont sur la brume qui participa au succès éditorial de la collection Une Heure Lumière à ses débuts. La novella, très poétique, insistait davantage sur l’ambiance d’un monde étrange que sur l’action réelle de son moteur narratif. Elle avait cependant marqué les esprits pour sa capacité d’évocation d’un monde à la marge.
Et c’est précisément ce qui fait aussi la force de sa Quête onirique de Vellitt Boe. Johnson a eu l’idée amusante d’imaginer La quête onirique de Kadath l’inconnue (H.P. Lovecraft, 1943 – publication posthume) à l’envers. C’est-à-dire d’imaginer la quête d’un habitant du pays des songes qui tenterait d’entrer dans le monde des hommes (le monde réel, de notre point de vue de lecteur). Le prétexte avancé tient la route : Vellitt Boe, une professeure au Collège pour femmes d’Ulthar est réveillée en pleine nuit. L’une de ses pensionnaires s’est enfuie avec un rêveur vers le monde des humains. La jeune femme en question, dont le père fait partie du conseil d’administration du collège en question, est également, incidemment, la descendante d’un Dieu endormis local qui n’apprécierait pas trop avoir perdu sa progéniture.
Dans ce monde onirique où les femmes n’ont qu’une importance toute relative et où l’existence même d’un collège pour femme est une grande victoire, un scandale pareil pourrait mener à la fermeture de l’établissement ou, pire, à la destruction complète de la cité par la déité dérangée. Bref ; aboutissement négatif ! Ni d’une ni de deux, Vellitt Boe, la cinquantaine bien frappée, décide de reprendre le bâton de pèlerin de sa propre jeunesse et de parcourir les contrées du rêve pour trouver un accès vers le monde réel et ramener la jeune femme dans son giron. Quitte à aller quémander une clé à son ancien amant, un certain Randoph Carter…
La quête […] oscille donc entre hommage et écrit militant. Johnson, on le découvre dans la postface sous forme d’entretien avec l’éditeur français, a toujours apprécié Lovecraft tout en étant consciente assez vite de son racisme crasse (comme je l’ai déjà dit dans ces colonnes, qu’il convient de contextualiser et non d’excuser). Son propos dans ce court roman est donc de rendre hommage à la vision de l’homme de Providence en « corrigeant » son propos. Pour cela, elle choisit évidemment une héroïne qui évolue dans un monde essentiellement féminin où les personnages sont LBGT et où les hommes « forts » sont plutôt lâches et faibles. D’où le militantisme féministe dont je parlais ci-dessus.
Quelques esprits chagrins sur le web y ont vu une exagération aussi déplacée que déplaisante. A la lecture du roman, cependant, cela ne m’a absolument pas sauté aux yeux. Évidemment, c’est sans doute cette démarche « à thèse » qui lui a valu de gagner un prix littéraire pour son roman (contre La ballade Black Tom, qui modernise également Lovecraft en l’attaquant sur son racisme, sans y ajouter toutefois la touche de féminisme qui semble être le combo gagnant). Mais peu importe. Le texte en lui-même est fort agréable et ces touches de militantisme ne gênent en rien la lecture. Cela rend au contraire le texte plus intéressant, car il jette un œil différent sur un imaginaire bien particulier très peu habité par les femmes.
Les amateurs de Lovecraft seront par ailleurs heureux de retrouver un texte qui respecte la mythologie lovecraftienne sans pour autant respecter le canon de l’œuvre dans son déroulé. En effet, Vellitt est un personnage actif là où les héros lovecraftiens subissent la plupart du temps le monde qui les entoure et les horreurs qu’ils vivent. Vellitt connait ce monde, l’a déjà parcouru et a déjà affronté ses dangers. C’est donc en toute connaissance de cause qu’elle traverse les contrées du rêve et se confronte tant aux dangers qui la guète qu’aux fantômes de son passé et aux espoirs déçus de sa vie. Le livre souffre peut-être d’un rythme hachuré, passant d’une exposition rapide à une seconde partie plus contemplative, presque guillerette par moment, qui tranche beaucoup avec une partie finale plus sombre et nettement plus explicite que tout ce que Lovecraft n’a jamais produit d’indicible.
L’un dans l’autre, La quête onirique de Vellitt Boe reste un bon roman d’aventure, un hommage intelligent qui tente également de faire passer un message. La plume de Johnson est agréable et elle n’hésite pas à plonger dans l’horreur quand le moment est venu de se confronter aux goules et autres ghasts. Elle confirme, quelques années après Un pont sur la brume, qu’elle est un nom sur lequel il faudra compter dans le paysage de l’imaginaire US, dans une veine assez proche de ce qu’a pu faire Nancy Kress ou Ursula Le Guin avant elle. Et le rapprochement est élogieux.

 De
De  De
De 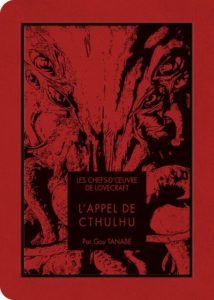 De
De 