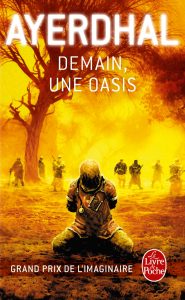 D’Ayerdhal, 1992.
D’Ayerdhal, 1992.
Ayerdhal, de son vrai nom Marc Soulier, fut un nom connu de la SF francophone dans les années 90. Décédé trop jeune en 2015, il avait un peu disparu des écrans avant que la maison d’édition Au diable vauvert ne se lance dans une réédition de ses œuvres dans la seconde moitié des années 2000. Réédition méritée, si l’on considère que ses textes n’ont rien perdu de leur mordant et de leur message.
C’est particulièrement le cas avec Demain, une oasis, qui fut en son temps le premier texte primé de son auteur (grand prix de l’imaginaire en 1993, l’année suivant l’édition originale) et son premier succès de librairie. En résumé, dans un futur proche, un médecin-chercheur bureaucrate se fait enlevé par une bande anonyme en sortant de son bureau genevois (il travaille pour la version future de l’OMS sur des statistiques médicales liées aux colonies spatiales). Le chercheur en question croit dans un premier temps à un enlèvement lié à une demande de rançon. Il va cependant assez vite se rendre compte que ce n’est pas le cas. Le groupe qui l’a enlevé est constitué de paramilitaires et d’autres médecins d’origine diverses, vivant au sein des plaines africaines désolées et tentant d’aider les populations locales du mieux qu’ils peuvent. En effet, afin de payer les voyages et l’installation des riches occidentaux dans l’espace, le peu de ressources dont disposait encore le Nord est siphonné au mépris de la vie des populations locales. Jusqu’à ce que celles-ci relèvent la tête de manière insoupçonnée…
Court roman coup de poing, Demain, une oasis nous expose aux affres d’un monde à deux vitesses, une politique néo-coloniale sourde qui continue à laisser crever de faim la moitié de la population mondiale pour le confort de l’autre moitié. Le Nord est toujours gagnant et le Sud toujours davantage perdant. Et Ayerdhal ne fait pas de concession : la violence crue des protagonistes, la misère exposée (qui n’est pas plus belle au soleil, contrairement à ce que dit la chanson) et les méthodes pour le moins questionnables utilisées par les « nouveaux humanitaires » au centre du récit font du roman un véritable pamphlet contre l’iniquité du colonialisme rampant qui persiste malgré les discours politique rassurants.
L’argument de la SF n’est d’ailleurs utilisé de manière intelligente qu’en fin de bouquin, pour ouvrir une porte vers l’espoir (ce qui est aussi inattendu que réjouissant, pour finir). En effet : la situation décrite pourrait s’appliquer moyennant quelques modestes adaptations à toutes les zones de conflit au Sud de l’équateur (et en Afrique en particulier, bien sûr). Le style d’Ayerdhal, sec, nerveux, sans concession, se marrie parfaitement avec le propos. Il parvient, par une description presque en négatif de ses personnage, à nous faire ressentir de l’empathie pour ces rebelles armés aux méthodes de barbouze. L’idée que la fin justifie les moyens, martelée par la cheffe rebelle, bien que contrecarrée au final par le protagoniste principal (qui perd bien vite son patronyme dans les camps de réfugiés surpeuplés du Sud-Sahara), semble produire ses effets. Au lecteur de juger si, en effet, l’échec des ONG charitable n’est pas de la responsabilité même de leurs donateurs, qui n’ont égoïstement aucun intérêt à ce que le Sud relève la tête, comme on nous l’explique ici de manière très directe.
Demain, une oasis est un beau texte d’espoir. Une leçon d’humilité qui nous force (lecteur, je t’englobe dans la classe moyenne européenne lambda, mes excuses si cela ne te représente pas !) à remettre en cause nos croyances et engagements petits-bourgeois. Ayerdhal avait la réputation d’être « l’homme énervé » de la SF française. Je confirme : son roman nous donne la leçon, sans pour autant en avoir l’air. Un bon petit bout de SF engagée et intelligente : à lire et à réfléchir.

 De
De  De
De 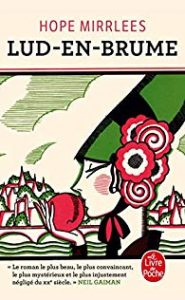 De
De 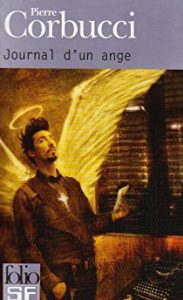 De Pierre Corbucci, 2004.
De Pierre Corbucci, 2004.