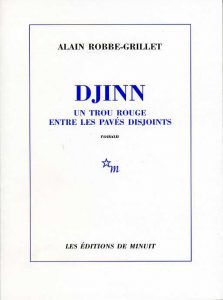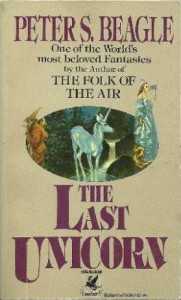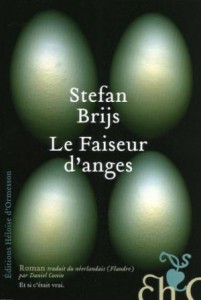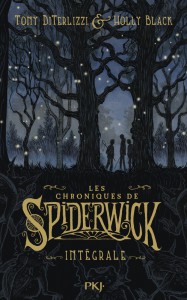Sous-titré « Une fantaisie corporate »
Lorsque Laurent Kloetzer écrit avec sa femme, Laure, ils prennent le nom de plume de L.L. Kloetzer (la double initiale faisant toujours très bien pour un auteur de SF ou de Fantasy). Je me souvenais encore après plusieurs années du plaisir de lecture que m’avait procuré La Voie du Cygne, un whodunit steampunk brillamment écrit et intelligemment construit.
Force est de constater que CLEER n’appartient pas du tout au même genre. En soi, cela n’est évidemment pas un problème. Mais c’est assez perturbant de passer d’un récit classique à un récit déstructuré. Car on peut légitimement se poser la question de la nature même de CLEER : est-ce un roman ? Un recueil de nouvelles ? Autre chose ?
En résumé, un entreprise internationale dont la nature et les produits sont peu défini (une sorte de super-Apple/Alphabet/zaibatsu d’Elon Musk) engage deux nouveaux collaborateur pour son service de cohésion interne (audit interne ? Stasi interne ?) : Vinh, un cadre ultra-ambitieux, obsédé par le résultat et par la maîtrise de son corps et de son esprit et Charlotte, une « éponge » des multiples sources d’informations (informatiques ou non) qui livre toutes données, interprétations et perceptions nécessaires pour que les missions confiées soient menées à bien.
Ces deux nouveaux arrivants sont le fil rouge qui lie les différents chapitres, les différentes missions qui composent le livre. Et la progression du livre est, pour moi, fort étrange. Les premières missions sont relativement linéaires et rédigées à la manière d’un whodunit. Les dernières, quant à elles, sont plus sensorielles que romanesques. Pas de problème avec ce type d’artifice, de technique littéraire si cette transition se fait de manière progressive. J’ai cependant eu l’impression, ici, que le ton et, donc, la forme, ont changé du tout au tout d’une page à l’autre entre deux missions.
Et j’avoue avoir un peu de mal avec le côté brouillon, parfois difficilement lisible, d’une écriture sensorielle. L’utilisation d’un vocabulaire décalé, organique pour décrire des process informatique, par exemple, est une bonne idée en soit (un hommage déguisé aux obsessions de Cronenberg quand il tourne de la SF ?), mais rend la lecture inutilement complexe par moment. De même, la novlangue managériale, qui a évidemment du sens vu le contexte, n’est pas forcément extrêmement agréable à lire. Certains passages m’ont rappelé des rapports de consultants que je lis régulièrement avec des larmes de sang au bureau (larmes provoquées par la pauvreté du contenu comme de la forme).
En cela, CLEER démontre bien que les auteurs ont bien saisis les limites du métier qu’ils s’attribuent dans leur biographie imaginaire, à savoir consultant/sauveur de l’entreprise. La question est de savoir si je prends plaisir à lire cela dans une fiction. Malheureusement, le bilan est assez mitigé : j’ai eu beaucoup de mal à ressentir quoi que ce soit pour les personnages principaux et la chute finale, finalement prévisible, m’a laissé de marbre. Il faut reconnaître un certain brio dans l’écriture, mais je n’adhère pas au concept. CLEER : be yourself, n’est pas pour moi.
PS : avec ceci, peu de chance que je me retrouve sur le site élégiaque dédié au bouquin que ces auteurs ont mis en place ! 🙂