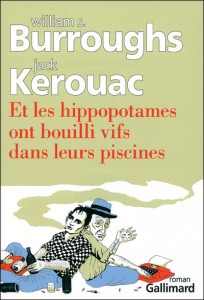De Charles Dantzig, 2015, Grasset.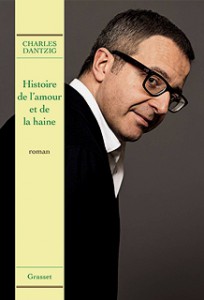
Écrit probablement pendant les manifestations anti-mariage gay à Paris en 2014, l’Histoire de l’amour et de la haine est un roman impressionniste. Le découpage non en chapitres linéaires, mais en moments correspondants à un sentiment particulier, en ce compris l’amour et la haine, provoque cette sensation de parcourir une mosaïque davantage qu’une histoire à proprement parler.
La multiplication des personnages –le vieil écrivain en pane d’inspiration, le jeune homosexuel en révolte, le couple gay établi, le député anti-gay hargneux, la femme trop belle pour être aimée–, dont les avis, les vues et les expériences se mélangent, renforcent encore la spirale narrative de cet objet romanesque non-identifié. Même le message de Dantzig est noyé au milieu de ce maelström : l’amour et la haine sont fort proches l’un de l’autre (notons au passage une goujaterie de la langue française : l’amour est masculin là où la haine est féminin) et ses personnages, toujours victimes d’une blessure plus ou moins sérieuse et plus ou moins secrète, ont du mal à faire le distinguo, tout comme l’humanité en général. Le cas le plus exemplaire est celui du jeune gay perdu dans sa situation familiale et amoureuse/amicale qui n’est jamais plus heureux que lorsqu’il laisse sa haine s’exprimer, quitte à basculer dans la violence.
Très intelligent et remarquablement maîtrisé dans le style, l’Histoire de l’amour et de la haine laisse cependant dans la bouche comme dans les yeux un goût de trop et de trop peu. Trop court pour être romanesque, trop long pour être pamphlétaire. Trop vulgaire, à l’occasion, pour être beau et en même temps trop réservé pour être honnête. Dantzig hésite, comme ses personnages, entre les mondes, les styles, les expériences et les constructions. Obéissant à certaines sirènes de l’auto-fiction sans l’avouer (le name droping discret mais présent, le recours à des formes aussi peu littéraires que la liste ou le tableau comparatif, façon Beigbeder, la description crue de la sexualité, etc.), on en fini par se poser quelques questions sur la vanité de l’entreprise.
Il n’en demeure pas moins que Dantzig est un écrivain érudit qui maîtrise la langue dans toute sa souplesse et sa richesse et qu’il réussi à signer un récit choral qui prend son sens, comme dans la peinture impressionniste, lorsque l’on s’éloigne un peu des pages et que les mots deviennent flous pour former un tout. Une lecture agréable et enrichissante, mais probablement trop superficielle pour laisser une marque indélébile, ce que son sujet aurait certainement mérité, la forfanterie réactionnaire d’une proportion non-négligeable du peuple français de 2014 étant trop rapidement passée sous silence pour être bien saisie.