 De Lauren Schmidt Hissrich, 2019.
De Lauren Schmidt Hissrich, 2019.
Il me faut débuter cet article par un disclaimer : je n’ai jamais joué aux jeux vidéo The Witcher et je n’ai pas encore entamé la saga romanesque d’Andrzej Sapkowski. Du coup, je n’avais pas réellement d’apriori en débutant la saison 1 de ce qui fut annoncé comme le successeur de Game of Thrones. J’ai laissé un peu de temps passer avant de la découvrir en raison des échos assez moyens que j’en avais lu ici et là sur le net ces derniers mois. Et plus prosaïquement car je n’avais pas beaucoup de temps pour bingwatcher une série, aussi courte fut elle, ces derniers mois, ma priorité allant à la lecture dans mes rares moments de loisir.
Mais j’ai quand même fini par m’y lancer. Et… j’ai mis un peu de temps à rentrer dedans, soyons honnête. Le premier épisode, sympathique, nous lance dans un monde de fantasy lambda avec un héros lambda qui accompli une quête lambda. Bon, ok, de manière plus sombre que la moyenne. Mais le rythme un peu lent et l’absence de background, toujours essentiel quand on se lance dans un monde fantastique que l’on ne connait pas, m’ont laissé un peu froid. J’avais l’impression d’être dans une copie « pour adulte » de Xena. Je suis sévère, mais la réalisation n’était pas formidable et les effets spéciaux assez cheaps. Heureusement, la chorégraphie des combats et les quelques aperçus d’un monde plus complexe et d’une histoire intéressante m’ont poussé à continuer.
Le deuxième épisode, lui aussi assez anecdotique, m’a fait craindre le spectre d’adaptations fauchées de récits usés jusqu’à la corde, comme l’infamante version MTV de Shannara il y a quelques années, ou le Legend of the Seeker de Sam Raimi. Le parallèle, à nouveau, est un peu injuste puisque dans les deux cas cités, l’œuvre d’origine n’est ni très originale ni d’une qualité littéraire irréprochable. Puis, vint le troisième épisode. Et le quatrième. Et les six suivants, dévorés en quelques heures. S’il est évident que Netflix n’a pas mis le paquet, niveau moyens de production, dans cette première saison, rendant une copie passable question réalisation et effets spéciaux (le dragon de je ne sais plus quel épisode fait quand même ‘hachement mal aux yeux après ceux de GoT), la série est très largement sauvée par son scénar et par le monde qu’elle développe.
Bien qu’encore largement entourée de mystères, on se doute que l’arc narratif de Geralt De Riv sera passionnant. Il est le représentant d’un ordre ou d’une caste (pas tellement clair à la fin de cette première saison) qui arrive en fin de vie. Le chasseur de monstres, qui semble immortel, n’a clairement pas la vie facile. Et sous ses dehors bourrus (interprété par un Henri Cavill parfois à la limite de la caricature, avec force grognements à la clé), on sent qu’il a effectivement le potentiel du héros de fantasy qui sauvera la veuve et l’orphelin. Dans le rôle de la veuve, on a celle qui est selon le moi le meilleur personnage de la série, à savoir l’ex-difforme Yennefer De Vengeberg, magicienne de son état qui apprends le grand Art à coup, littéralement, de sang et de sueur. Et dans le rôle de l’orphelin, la charmante Cirilla, héritière d’un royaume dévasté et réceptacle de pouvoirs qui restent, au terme de cette première saison, bien mystérieux. Pas grand chose d’autre à dire sur elle, puisque Cirilla subit les évènement dans ce première saison et n’a pas réellement un rôle proéminent.
Et lorsque la sauce commence à prendre, la mayonnaise est franchement réussie. C’est peut-être l’excellent personnage secondaire joué par non-moins excellent Joey Batey, le barde Jaksier, qui fait balancer la série vers quelque chose d’éminemment plus sympathique et plus passionnant. Jaksier, le cliché du barde lâche et obséquieux, en même temps qu’il est formidablement drôle et efficace, fait un side-kick bienvenu au ténébreux witcher. Il l’humanise avec ses chansons ridicules (mais que j’écoute en boucle depuis que j’ai terminé la série – les musiques, signées par Sonya Belousova et Giona Ostinelli valant leur pesant de cacahouètes) et offre un point d’ancrage au spectateur. Et lorsque l’histoire de Yennefer se développe, triste, grandiloquente et passionnante, on est véritablement accroché.
Mon petit cœur de fanboy de fantasy ne cesse donc d’espérer la fin du COVID-19 pour que reprenne le tournage de la saison 2 afin qu’elle puisse sortir si pas en 2020, au moins quelque part en 2021. Car les producteurs de la série ont en plus osé des choses avec la construction scénaristique. Il m’a fallu quelques épisodes pour comprendre, comme beaucoup d’autres spectateurs, si j’en crois Internet, que les trajectoires des trois héros, Gerlat, Yennefer et Cirilla, appartenait à trois temporalités différentes, parfois distantes de plusieurs dizaines d’années. Avoir deux protagonistes qui ne souffrent pas des affres du temps (Geralt et Yennefer) permet évidemment cette construction asynchrone des épisodes. J’en profite pour tirer mon chapeau aux scénaristes ayant œuvré sur l’adaptation télé pour avoir « reconstruit » une narration fluide à partir de nouvelles éparses du matériau d’origine. Car la série romanesque The Witcher du polonais Sapkowski débute par deux recueils de nouvelles avant de nous embarquer dans une série de romans qui racontent une épopée plus linéaire et classique. Et les producteurs de la série télé ont pris le risque d’adapter les nouvelles et non de débuter les romans, ce qui donne cet aspect parfois décousu entre les épisodes, certainement au début de la série. Mais cela permet de montrer l’ »origin story » de nos trois héros sans user de nombreux flashbacks dans les prochaines saisons.
J’ai cru comprendre que cela avait perturbé nombre de spectateurs qui reprochaient à Netflix une intrigue trop complexe. Mouais. Faudrait quand même voir à pas exagérer : si on est surpris quand on comprend finalement que les temporalités se croisent et se chevauchent parfois, il ne faut pas un PHD en astro-phyique pour analyser l’ensemble quand on a capté l’astuce. Et The Witcher reste, aussi, de la fantasy classique et efficace, avec son lot de monstres divers, de magiciens étranges et de bardes grivois. Donc une histoire à la portée de n’importe quel amateur de légende ou de récit héroïque. Avec juste ce qu’il faut de nudité pour attirer le chaland habitué à cela depuis The Tudors/GoT/Spartacus, etc.
Pour conclure, je dirais simplement que The Witcher est clairement une bonne surprise. Si Netflix réalise qu’il a là non pas un successeur à GoT (ce n’est pas de la fantasy de grands conflits, mais bien de la fantasy plus intimiste qui se déroule, il est vrai, dans un monde en conflit) mais simplement une très bonne histoire de fantasy, il faut espérer qu’ils donneront un peu plus de moyens à la saison 2 pour que la réalisation et ses artifices se rapprochent davantage des standards des séries télé modernes. Ce qui, à première vue, pouvait donc être un nanard sympathique, est en fait une longue introduction en dix épisodes de 50 minutes à ce qui promet d’être une saga riche, dramatique, sombre et passionnante de dark-fantasy. Que demande le peuple, si ce n’est à la saison 2 de confirmer tout cela ?
PS : Et il faut que quelqu’un dise à Henri Cavill que porter des pantalons en cuir moulant quand on est assez musclé, ça… grossit. Du coup, le witcher a l’air parfois un peu boudiné dans son attirail de chasseur de monstres ce qui, je l’imagine, n’était pas l’effet recherché. ?
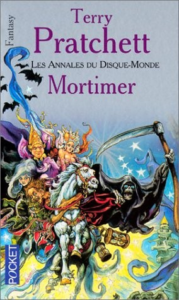 De Terry Pratchett, 1987.
De Terry Pratchett, 1987.
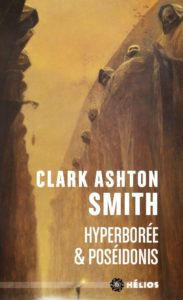 De
De  Sous-titré : Le trouble du héros
Sous-titré : Le trouble du héros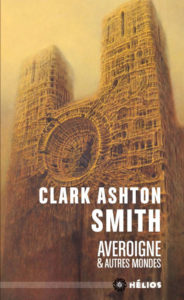 De Clark Ashton Smith, 1930-1951.
De Clark Ashton Smith, 1930-1951. De
De