 De Francis Berthelot, 2005.
De Francis Berthelot, 2005.
Je ne connaissais Francis Berthelot que pour l’essai Bibliothèque de l’Entre-mondes consacré aux transfictions, publié chez Folio SF en 2005 déjà. Mais je n’avais encore jamais rien lu de sa production romanesque. Voilà qui est chose faite avec ce court roman fantastique, lui aussi publié initialement en 2005. Tome 6 du grand œuvre de Berthelot, la saga Le Rêve du démiurge en comptant au total 12, Hadès Palace peut cependant parfaitement se lire indépendamment des autres titres. Si j’ai bien saisis le concept, si certains personnages sont communs à l’univers et se croisent d’un tome à l’autre, il n’en demeure pas moins que chacun nous conte une histoire indépendante.
Hadès Palace nous confronte avec le personnage haut en couleur qu’est Maxime Algeiba. Il s’agit d’un artiste de cirque/cabaret, connu pour ses capacités exceptionnelles de mime. Forte tête, volontiers crâneur, il est plus que flatté lorsqu’un inconnu qui se présente comme l’imprésario de l’Hadès Palace le contacte un soir dans un bar interlope où il vient de se produire. L’Hadès Palace a une réputation sulfureuse dans le milieu artistique : c’est the place to be, mais c’est aussi un endroit d’où l’on ne revient que rarement, visiblement, puisque nombre d’artistes ont rejoint ses rangs pour disparaître complètement de la circulation par après. Maxime accepte, bien sûr, de rejoindre les rangs de la troupe du mystérieux maître des lieux, Bran Hadès.
Cependant, il va bien vite déchanter : entraînements éprouvants, brimades, service de sécurité interne qui a la main lourde, torture au minimum psychologique, le Palace n’est pas aussi sympathique que les dorures qu’il exhibe a ses riches clients. Et il semble impossible de s’en échapper, par on ne sait quel obscur lien qui unit les artistes pleins d’espoir qui ont accepté de s’y produire et leur ténébreux hôte… Rondement mené, Hadès Palace nous ouvre les portes de l’imaginaire de Berthelot : gothique, par bien des aspects, glauque, parfois et ironique, souvent. La plume de Berthelot, intelligente sans chercher à impressionner, sert ce récit simple d’une littérale descente aux enfers d’un anti-héros qui n’a pas l’intention de se laisser faire.
On y croisera une galerie de personnages hauts en couleur, un amour certain pour les métiers de la scène, l’attirance au milieu du chaos ou encore la présence de quelques monstres très classiques sortis d’un film de la Hammer remis au goût du jour. Hadès Palace est donc un roman qui mélange les genres, qui s’attarde tant sur le développement de ses éléments fantastiques que sur une étude de mœurs dans un contexte quasi-carcéral. L’un dans l’autre, le roman est agréable à lire et se parcourt très vite. Peut-être même un peu trop. Et c’est probablement son défaut : à vouloir enchaîner les scènes rapidement, peu de personnages sont finalement développés et l’on reste par moment sur notre faim par rapport à certaines pistes évoquées au détour d’un chapitre. Évidemment, cette impression fragmentaire est sans doute corrigée par la lecture de l’ensemble de la saga, mais j’hésite encore à poursuivre plus avant. Si le livre est agréable, je n’en garde pas pour autant un souvenir impérissable et d’autres sagas dans ma PAL me font bien davantage de l’œil. Bilan finalement assez mitigé, donc.

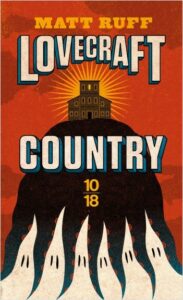 De
De 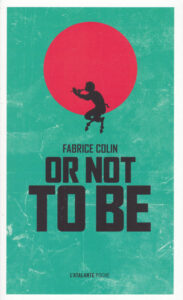 De
De 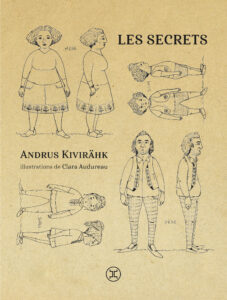 D’
D’ De
De