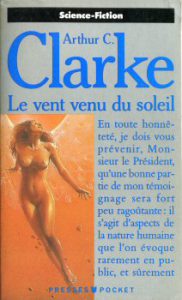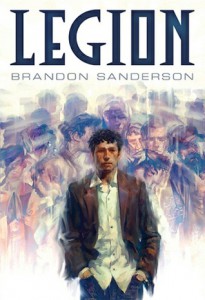Divers, 1950-1970
Divers, 1950-1970
Contient:
La main tendue, de Poul Anderson, 1950
Audience captive, d’Ann Warren Griffith, 1953
La montagne sans nom, de Robert Sheckley, 1955
La vague montante, de Marion Zimmer Bradley, 1955
Le mercenaire, de Marc Reynolds, 1962
Le pense-bête, de Fritz Leiber, 1962
Continent perdu, de Norman Spinrad, 1970
La maison d’édition Le passager clandestin, davantage spécialisée dans la littérature contestataire et les écrits politiques, entretient depuis quelques années une collection de science-fiction. La collection, appelée Dyschroniques, a pour vocation la réédition des textes courts (nouvelles ou novellas) de grands noms de la SF des années 50 aux années 70. Le point commun entre ces textes est qu’ils préfigurèrent, de manière claire ou détournée, des travers de la société actuelle : une réelle littérature d’anticipation, pour le coup (par exemple le ciblage publicitaire, dans Audience captive).
Chaque texte est en sus suivi d’une courte biographie de l’auteur ainsi que d’un contexte historique en quelques dates et faits marquants. Ces éléments permettent de passer de l’autre côté du miroir et de s’imaginer d’où vient l’imagination fertile des différents écrivains. Les volumes se concluent avec une courte liste de films et de livres traitant de la même thématique, liste qui a peut-être un peu moins d’intérêt, car elle ne fait que reprendre des grands classiques que l’amateur de SF connait déjà pour la plupart.
Un dernier mot sur l’édition avant de passer au contenu : les sept nouvelles sont reprise dans un coffret cartonné qui n’est malheureusement pas d’une solidité à toute épreuve. Les bouquins en eux-mêmes, de très petit format, sont très épurés et très beaux et sont très pratiques à emportés partout. Certes moins beaux que les volumes de la formidable collection Une Heure-Lumière du Bélial, ces courts textes ont l’avantage d’être moins cher. Entre 6 et 8 euros le tome, 30 et quelques pour le coffret ; à ce prix-là, pas d’hésitation à avoir. Mais place maintenant au contenu.
La main tendue, de Poul Anderson, fleure bon la SF de l’immédiate après-guerre. Dans la nouvelle, une peuplade extraterrestre refuse l’aide de la Terre pour se reconstruire après une guerre l’ayant opposé à un voisin galactique (alors que ce dernier accepte l’aide). Le texte est une charge très lucide contre le plan Marshall et inféodation qu’il engendre, tant d’un point de vue économique que scientifique, culturel ou social. Longtemps avant que l’on parle de globalisation, Poul Anderson avait donc anticipé justement le risque de la main-mise de l’Oncle Sam sur ses ouailles, suite à une politique de la main tendue qui ne cache presque pas ses ambitions assimilatrices.
Audience captive, de la méconnue Ann Warren Griffith, tient davantage de la farce que de la nouvelle. Elle dénonce dans ce très court texte, à rapprocher des courtes nouvelles satiriques d’Asimov, Frédéric Brown ou encore K. Dick, les méfaits du spamming publicitaire. C’est d’autant plus amusant qu’elle décrit le ciblage publicitaire à travers l’ajout de puce (RFID ?) sonore sur les produits commerciaux. Bien qu’elle finisse par anticiper la main-mise de la télévision sur le culte du « commercial » (proche de celui qui lui est voué dans Demolition Man), elle ne pensait sans doute pas être encore davantage visionnaire en imaginant l’objet connecté qui fait sa propre pub…
La montagne sans nom est un autre texte assez court. Robert Sheckley y décrit une équipe de terra-formateurs au prise avec la population locale d’une planète ressource encore à vendre, mais également au prise avec une menace nettement plus complexe : la révolte de la nature elle-même. Écrit en 55, on peut y voir les prémices de la révolution hippie, le retour à la Terre, l’écoute de Gaïa. Sauf que Gaïa, ici, comme dans le Signs de Shyamalan bien des années plus tard, n’est en fait plus tellement sympathique envers le genre humain.
Dans La vague montante, Marion Zimmer Bradley, cela fleure bon également la réflexion sur le retour à la Terre. Sans aller jusqu’à un rejet de la technologie, la nouvelle nous conte le retour sur Terre d’un groupe de colons de l’espace, deux générations après le départ de leurs aïeux vers de nouveaux cieux. Et quel n’est pas leur surprise de constater que la bonne vieille société américaine a décidé d’en arrêter avec la course au progrès et a préféré se recentrer sur un mode de vie agrarien, en petite communauté, où chacun à sa place et participe selon ses compétences. Probablement le texte le plus faible de l’anthologie, La vague montante est pour moi un peu trop naïf sur les rapports humains et la construction sociale pour avoir l’impact qu’il souhaitait sans doute avoir. C’est la même raison, d’ailleurs, qui fait que je n’ai pas réellement accroché au grand œuvre de Zimmer Bradley, Ténébreuse.
Le mercenaire est signé par Marc Reynolds en 1962. L’auteur, très discret, n’est autre que le fils du candidat socialiste (oui, vous avez bien lu) aux élections présidentielles américaines de 1924, 1928 et 1932. Et il lire ici un texte étrange, dont j’ai du mal à déterminer si elle est une charge contre la course à l’armement ou une réflexion sur l’inanité de l’innovation technologique. Il s’agit de l’histoire d’un mercenaire vétéran dans un monde où les sociétés commerciales règlent leurs différents sur un champs de bataille (uniquement avec des armes et techniques d’avant 1900) en lieu et place du tribunal. Et ces sociétés de s’acheter les services de mercenaires/stratèges pour défendre aux mieux leurs intérêts. Le twist final vaut à lui seul le plaisir de lire la nouvelle, qui dilue bizarrement son propos en accordant trop de place à ses protagonistes.
Avec Le pense-bête, écrit par Fritz Leiber en 1962, on rentre dans une SF plus moderne, plus noire, plus cynique. Ici, un romancier fantasque (un double de Leiber ?) vend ses idées à des commerciaux dans une société post-apocalyptique où la majeure partie de la population vit sous terre. L’une de ses idées est la création d’un secrétaire automatique/robotique qui vous permettrait de ne plus rater quelque chose en raison de votre mémoire défaillante. Et le modèle est un succès sans précédent. Bientôt, tout le monde a son assistant personnel. Et tout va bien jusqu’à ce que la machine se mette à penser par elle-même. Probablement écrit sous acide (certains passages volent très haut!), le récit se lit d’une traite, même si , depuis 2001 L’Odyssée de l’Espace et Terminator, on commence à anticiper ce qui se passe lorsque l’on laisse trop d’espace à nos machines favorites. A lire en gardant en tête ce que notre smartphone fait pour nous (ou la manière dont il dicte nos vies ?)
Continent perdu, de Norman Spinrad, est à mes yeux le petit bijou de cette anthologie. Rédigée en 1970, à une époque où la SF devenait plus cynique qu’idéaliste, cette novella traite de manière très frontale du racisme de la société américaine. En le renversant. Nous sommes ici sur une Terre qui connu les affres d’une sur-polution excessive où les USA ont perdu leur position dominante au profit du continent africain. Et des touristes africains, pour diverses raisons, viennent visiter le New York de l’âge de l’exploration spatiale, ville-musée morte dans sa gange de polution. Les touristes payent leur tickets et seront embarqués dans l’hélicoptère d’un américain blanc, fruit rebelle d’une société soumise, qui les menèra dans une expédition dont personne ne sortira indemne. Alternant les points de vue du pilote blanc et d’un universitaire noir africain, le texte une veritable réussite qui allie le propos, le style, le suspens et des personnages fouillés, malgré la taille relativement modeste du bouquin (120 pages plus ou moins). On y retrouve un Spinrad inspiré, revanchard, qui signe ici un texte coup de poing qui marque également par sa poésie incongrue. Du tout bon.
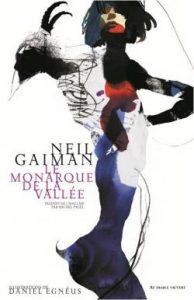

 Divers, 1950-1970
Divers, 1950-1970