 De J.G. Ballard, 1966.
De J.G. Ballard, 1966.
J.G. Ballard est l’un des grands noms du renouveau de la SF britannique des années 60, aux côtés de Brian Aldiss ou Christopher Priest. Je ne le connaissais jusqu’à présent que par les adaptations cinématographiques de ses œuvres : le Crash de Cronenberg, histoire de SF urbaine portant sur le sado-masochisme dans la relation de l’homme avec la mécanique et L’empire du soleil, l’un de mes Spielberg préféré, basé sur un récit partiellement autobiographique de l’auteur lorsqu’il fut contraint de fuir Shanghai suite à l’invasion du Japon lors de la seconde guerre mondiale. Ballard, joué par un très jeune Christian Bale dans l’adaptation ciné, passera plusieurs années années dans un camp de prisonniers avant de quitter la colonie et de revenir au Royaume-Uni où il sera confronté à une toute autre vie.
La Forêt de cristal, récit apocalyptique, doit sans doute beaucoup à l’expérience de vie de Ballard sous un régime colonial. Rédigé à la fin des années 60, qui vu indépendance d’une vingtaine de pays africains anciennement colonies des grandes nations d’Europe de l’Ouest, La Forêt de Cristal se déroule dans un Cameroun équatorial, en proie aux épidémies de lèpre et à la fin d’un régime. J’ai cherché comment résumer le bouquin avec un parallèle facilement compréhensible : je pense que le présenter comme un Apocalypse Now (lui-même adapté très librement de Heart of Darkness, un récit de Joseph Conrad se déroulant dans le Congo du début de la colonisation) sous acide. C’est sombre, désespéré et très bizarre.
En deux mots, nous y suivons l’histoire de Dr Edward Sanders, le patron d’une léproserie, qui se rend dans la ville de Mont-Royal pour y retrouver la trace d’un ancien collègue et de sa femme, qui fut un temps sa maîtresse. La ville, aux frontières de la jungle équatoriale, est aux premières loges pour assister à la naissance d’un phénomène étrange. Il semble que la jungle, la forêt profonde, se cristallise pour une raison inconnue. Dans les marchés de Mont-Royal apparaissent d’étranges objets en cristal, des sculptures de fleurs, de branches d’arbres, d’animaux. Le Dr Sanders n’a d’autres choix que de remonter clandestinement le fleuve qui le conduira à l’hôpital de brousse de son ancien collègue, alors que l’armée prends progressivement le contrôle sur les environs.
Et le récit de s’enfoncer dans un délire hallucinogène où le Dr Sanders croisera divers personnages hauts en couleurs qui auront tous une motivation particulière pour se rendre, littéralement, au cœur de la forêt de cristal. Le récit, qui ne souffre d’aucune explication, nous plonge donc dans une ambiance apocalyptique, renforcée par la moiteur insupportable des tropiques et la langueur d’un pays qui n’en peut plus de sortir de sa torpeur coloniale. Je ne sais s’il faut y lire une allégorie de la fin des dominions anglais sur le continent africain (sans doute?), mais si c’est le cas, Ballard est loin d’être optimiste sur l’avenir. Tant celui de la civilisation en général que du devenir des anciens colons en particulier.
Il réussit, en plus, à maîtriser son sujet à la perfection : il parvient à nous faire ressentir une forme d’attraction perverse, sensuelle, pour cet environnement mutique, cristallin, à la fois magnifique et horrible. La Forêt de cristal est un grand texte, écrit dans un style brillant et intransigeant. L’ambiance, poisseuse, m’a fait pensé au passage de Voyage au bout de la nuit où Bardamu est colon au fin fond de l’Afrique noir. Si le style n’a bien sûr rien à voir (Ballard est nettement plus classique que Céline), le désespoir général, la vacuité de toutes tentatives ou efforts y sont similaires.
La Forêt de cristal se prête mal aux résumés ou aux commentaires. L’œuvre est une véritable expérience sensorielle, une plongée dans l’inconnu, dans la tentation du vide. Un superbe roman d’aventure, malgré tout, que les quelques paragraphes de ce billet n’esquissent qu’assez mal. Une œuvre qui mériterait des commentaires sans doute plus longs que son propre texte, tant la matière y est riche et l’impact important. Un chef-d’œuvre, en somme.

 De Joe Haldeman, 1976.
De Joe Haldeman, 1976.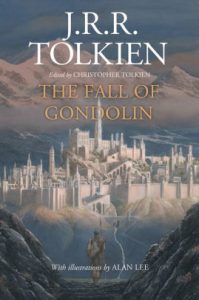 De
De 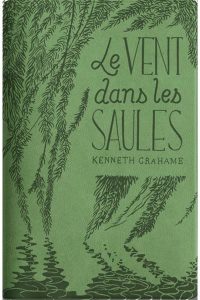 De
De  De
De