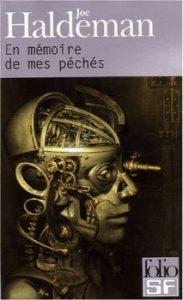 De Joe Haldeman, 1977
De Joe Haldeman, 1977
Rarement quatrième de couverture aura été si trompeuse ! Folio SF, en rééditant ce titre relativement méconnu en 2006, s’est contenté de reprendre celle de l’édition de Denoël – Présence du Futur de 1979. Ils auraient pu se fendre d’un nouveau texte de présentation, car celui-ci ne convient pas du tout. Croyant me lancer dans un roman comique, à la manière du Guide du Voyageur Galactique ou de recueils de nouvelles de Frederic Brown, je me suis retrouvé à lire un texte très sombre, à la limite du hard-boiled dans certains de ces développements.
Bon, ce n’est pas tout à fait un roman : il s’agit plutôt de trois nouvelles assez longues qui ont comme point commun de partager leur « héros« , Otto McGavin, un agent secret de la Confederaçion, sorte de gouvernement intergalactique chargé de défendre l’intérêt des divers habitants de la galaxie (citoyens ou indigènes plus ou moins intelligents). McGavin est un bouddhiste qui veut voir l’espace. Pas de bol, en s’engageant, il reçoit un conditionnement hypnotique pour en faire une machine à tuer. La Confederaçion dispose aussi d’une technologie particulière : le placage d’identité. Grâce à ce traitement hypnotique (et à peu de chirurgie esthétique, parfois franchement invasive), elle fait de ses espions des doubles de personnages publics vivants, politiciens, leaders religieux, hommes d’affaires, criminels, etc. Et la Confederaçion de les envoyer au front pour récolter des infos et jouer les gros bras si nécessaire.
Les trois nouvelles se déroulent à peu près le même schéma : McGavin arrive sur une planète exotique dans la peau d’un autre (un salopard de première) et tente de démêler le vrai du faux. Et malgré ses convictions initiales pacifiques, il fini toujours pas buter des gens, et pas forcément les antagonistes. Si l’on peut regretter que la mécanique du récit se répète (en gros, McGavin arrive, il pose des question à tout le monde jusqu’à ce qu’il confronte, ou soit piégé, par le traitre) et qu’Haldeman est parfois un peu paresseux dans le développement de ses personnages, l’ensemble est plutôt bon.
Les nouvelles sont articulées entre elles par de courts textes où McGavin est interrogé par les préparateurs mentaux de la Confederaçion. Ces interviews montrent la lente plongée dans la dépression et la folie du personnage principal. Forcé de progressivement effacer sa propre personnalité au profit des diverses personnalités peu reluisantes qu’il endosse, le pauvre McGavin se perd finalement totalement quand il comprends que la Confederaçion est nettement moins altruiste qu’elle n’y parait. C’est en effet ses propres intérêts qu’elle défend avant ceux des espèces locales.
Alternant plusieurs mondes imaginaires bien construits, peuplés d’extra-terrestres ou de peuplades locales originales et bien pensées, les trois nouvelles qui constituent le récit principal d’En mémoire de mes péchés se lisent d’une traite. On ne peut que compatir avec McGavin et ses remords, la seule chose qui lui reste, sa seule part d’identité d’origine. On rigole pas des masses, donc, contrairement à ce que l’éditeur promet. Pour faire une parallèle cinématographique, on est plus dans l’Armée des Douze Singes que dans du StarWars, en gros.
A ma grande honte, je ne connaissais absolument pas Joe Haldeman avant de lire ce bouquin. Le bonhomme est pourtant multi-primé (5 Hugo, 5 Nebula ,4 Locus) et a écrit un bon paquet de bouquin de SF. Je me mets de ce pas à la recherche d’autres titres du bonhomme. Même si c’est de la SF qui accuse un poil son âge, elle reste, de fait, très agréable à lire, même si franchement morose.

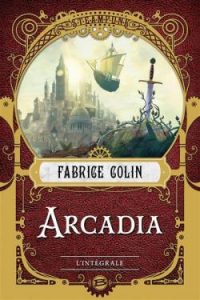 De
De 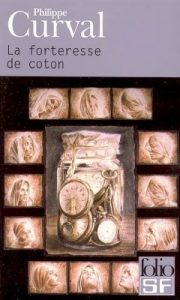 De
De 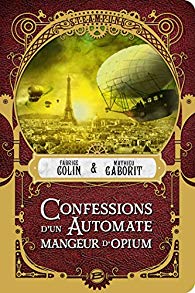 De
De  La trilogie cosmique, tome II
La trilogie cosmique, tome II