 D’Alain Damasio, 2004.
D’Alain Damasio, 2004.
Difficile d’être original dans une critique sur un bouquin devenu un classique de la fantasy française. A peu près tous les blogs actifs sur les littératures de l’imaginaire ont chroniqué le roman de Damasio à un moment ou l’autre de leur existence virtuelle. En effet, La Horde du Contrevent est réellement devenu un classique : publié chez La Volte en 2004, maison peu habituée aux succès de librairie, le roman a bénéficié d’un bouche-à-oreille tellement positif qu’il a fini par se vendre à plus de 200.000 exemplaires, ce qui est un très très bon score pour de la fantasy francophone. Il est d’ailleurs toujours présenté en bonne place sur les étals des commerçants culturels, genre FNAC et autres (dans sa version poche, chez Folio SF).
Et je comprend parfaitement la raison de son succès. Damasio, que j’avais lu il y a quelques années dans ses formats courts (Aucun souvenir assez solide, également chez Folio SF), est un amoureux de la langue française et joue avec le verbe probablement mieux que l’écrasante majorité des auteurs de SF & fantasy. Là où ses nouvelles se construisaient autours d’un concept linguistique, Damasio a habillement intégré cet amour particulier du mot dans la narration de La Horde. Avec un mécanisme, à priori, simple : en multipliant les points de vue, puisque chacun des membres de La Horde s’exprime à la première personne au sein du récit, identifié par un glyphe personnel en début de paragraphe, Damasio peut ainsi créer, artificiellement, une grosse dizaine de « façon » d’écrire différente. De la gouaille rocailleuse de Golgoth, le traceur et chef de bande, à la verve bondissante de Caracolle, le troubadour, en passant par le langage davantage posé de Sov, le scribe ou de Pietro, le diplomate (tous deux fort utilisés quand il s’agit de faire avancer l’intrigue), les personnages et les styles s’enchaînent au plus grand bonheur de leur auteur.
Damasio s’amuse en sus à casser le rythme classique du roman d’aventure, en maniant l’ellipse à foison, plusieurs années s’écoulant d’une page à l’autre alors que la majorité des chapitres insistent sur le temps réel. Cela peut déstabiliser le lecteur habitué à une lecture plus linéaire, mais permet de faire avancer une histoire qui aurait pu s’étendre sur plusieurs milliers de pages là où elle n’en fait que 650 dans sa version poche. Le choix des passages développés n’en est que plus significatif : lorsque la Horde a à subir plusieurs épreuves successives pour traverser une ville, seule l’épreuve de la joute verbale est détaillée in extenso. Cela permet à Damasio, à travers le toujours bondissant Caracolle, d’aligner les rimes et les palindromes avec un bonheur certain.
Mais tout ceci sert-il l’histoire ? La Horde du Contrevent est l’histoire d’une quête impossible. Une vingtaine d’hommes et de femmes sont élevés depuis l’enfance pour remonter, à pied, à l’extrême-amont, à la source du vent qui coule uniformément du Nord vers le Sud. En partant de l’extrême Sud, la Horde affrontera des années durant la rigueur d’un monde inhospitalier pour aller ne fut-ce qu’un pas plus loin que la génération précédente. Car cela fait huit siècles que des Hordes se lancent à corps perdu dans la recherche de la source des vents, l’extrême-amont, en espérant y découvrir des réponses (même si les questions ne sont jamais formulées). Et huit siècles qu’elles échouent. Mais cette Horde, jugée la plus rapide, la plus complète, la plus forte, porte l’espoir d’un monde pour y parvenir.
En chemin, ils affronteront les diverses formes du vent, de la simple bourrasque à la plus formidable tempête (et au-delà), les mystérieux chrones et les rares humains qui s’opposent, pour des raisons diverses, à leur quête. Et ils s’affronteront surtout eux-mêmes, leurs doutes, leurs dissensions internes, les conflits (inter-)personnels. En résumé, une quête épique menée par des femmes et des hommes en proie à leurs propres démons, un livre-univers qui a l’intelligence de ne se dévoiler qu’indirectement, à travers des trajectoires individuelles parfois contradictoires. Il règne, en plus, une ambiance de fin d’époque sur le roman : la Horde est un instrument du passé, vivant dans la gloire de sa renommée, petit à petit rattrapée par le développement technologique qui utilise le vent et ne se contente plus de lutter contre lui. Une certaine déliquescence qui accueille volontiers la mort, souvent présente, et qui fait la part belle à une interprétation philosophique de leur combat, de la place et de la signification du vent.
On l’aura compris à la lecture de ces quelques lignes qui tentaient tant bien que mal de résumer l’histoire et les enjeux abordés, La Horde du Contrevent est un roman complexe, doté de nombreuses clés de lecture et proposant un palette de personnages « bigger than life » aux quêtes personnelles liées intimement à la quête principale, moteur scénaristique du livre. Pour autant, l’alchimie entre ce programme et une écriture exigeante marche-t-elle ? C’est, je pense, l’explication du succès de La Horde : le lecteur de SF ou de fantasy standard, sans avoir aucune intention de le dénigrer ou même de le juger, n’a que peu l’habitude d’être confronté à un style exigeant. En cela, le livre est exceptionnel : il manie à merveille un fond classique (car si le monde développé dans La Horde est bien inédit, la logique d’une quête éternelle n’est pas réellement neuve dans la SFFF, voir par exemple La Tour Sombre) et une plume acérée. Le choc que cela peut créer chez le lecteur lambda en fait un livre mémorable. Et avec raison : il plane des kilomètres au-dessus de 99% de la production SFFF classique, en terme de qualité littéraire.
Pourtant, il cache à mes yeux une double-frustration. D’abord, Damasio a du contenir son amour de la langue pour malgré tout faire avancer l’intrigue. Et si quelques passages sont du bonheur pur, il y a aussi quelques lourdeurs qui rendent le texte plus indigeste que fluide (ce qui est particulièrement dommage pour un livre sur le vent). Vouloir à tout prix expérimenter en permanence avec le style est un exercice périlleux : le trop plein n’est jamais loin. Et c’est très limite, par moment. Là où cela fonctionnait dans ses nouvelles, dédiées à un concept linguistico-stylistique, l’expérimentation de la novlangue se révèle un peu lourde à la longue, devenant davantage un obstacle au ressenti qu’une aide au propos.
Ensuite, l’histoire elle-même souffre selon moi de certains partis-pris stylistiques. La multiplication des points-de-vue, des temporalités et des styles rend complexe l’entrée dans le roman. Pour être franc, c’est un bouquin qui m’a prit de longs mois à finir, entrecoupés de nombreuses autres lectures. Je ne me suis réellement sentis concerné par le développement de la quête et le devenir des personnages qu’après la moitié à peu près du tome. Il m’a fallut attendre la traversée de la « flaque » pour que j’accroche réellement au propos du livre. Et si je tire mon chapeau pour l’effort d’écriture, il est un peu dommage de constater que je ne suis réellement rentré dedans que pour les 200/250 dernières pages. A titre d’exemple, les morts successives ne m’ont pas réellement touchées jusqu’à ce qu’on arrive aux personnages réellement développés.
On ne retient en définitive que quelques personnages : le Golgoth, Caracolle, Pietro, Erg, Oroshii et, dans une moindre mesure, Sov. Soit six personnages sur les dizaines que compte le roman. Dommage… Autre faiblesse, probablement voulue par l’auteur : les fausses-pistes. Qui est l’organisation qui chasse la Horde ? Quel est son but ? Que sont réellement les chrones ? Autant de questions posées qui ne trouvent pas de réponse. En soi, ce n’est pas un problème, si ce n’est que cela a tendance à dévier le récit de son essence sans réellement apporter une pierre utile à l’intrigue, même indirectement.
Il m’est difficile d’oublier ces réserves pour crier, comme tout le monde, au génie. Ne nous trompons pas : c’est un très bon bouquin, riche, inattendu et innovant. Mais aussi frustrant. Damasio, pour habille qu’il soit avec les mots, n’est pas non plus Perec. Certaines de ces expérimentations sont un peu poussives, transformant la rigueur en acharnement et le plaisir en effort. Une lecture cependant indispensable pour les fans de SFFF, pour s’élever au-dessus de la « big-selling-fantasy » classique à l’américaine, mais probablement pas à conseiller à un novice.
Je suis particulièrement curieux de découvrir l’adaptation en jeu vidéo ou, mieux encore, en film d’animation. Elles pourraient reprendre la force non-négligeable de ce récit en gommant certaines de ses scories. Réduire l’histoire à sa plus simple expression serait sans doute salvateur. Mauvaise nouvelle, cependant, les adaptations vidéoludique et animée sont au point mort depuis des années maintenant (malgré la présence de Jan Kounen et Marc Caro pour cette dernière). Reste la récente BD, prévue en quatre ou cinq tomes, pour vérifier si l’on peut faire mieux que Damasio avec le même matériau de base. A découvrir.
 D’Ellen Kushner, 1990.
D’Ellen Kushner, 1990.
 De
De  De
De 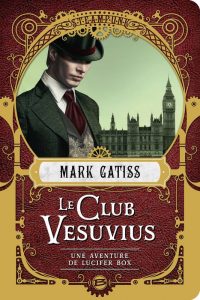 De
De  D’
D’