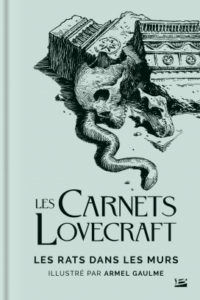 De Howard Philip Lovecraft & Armel Gaulme, 2020.
De Howard Philip Lovecraft & Armel Gaulme, 2020.
Bragelonne, qui a senti le filon, persiste et signe avec ses diverses publications lovecraftiennes. Ils ont débuté il y a peu de temps la publication en petit format poche de « grands textes » de l’homme de Providence, mais je n’en parlerai pas ici, car je me réserve pour l’intégrale de Mnémos qui est toujours quelque part en cours de traduction. Amusant de constater d’ailleurs que ces nouvelles éditions de Bragelonne bénéficient elles-aussi de nouvelle traduction, ce qui fait que certains classiques de Lovecraft auront connu jusqu’à 3 ou 4 nouvelles traductions FR en quelques années. Un beau cas d’école pour des étudiants en fac de traduction qui chercheraient un sujet de mémoire ! Malgré le hype commercial, je n’ai cependant pas résisté au plaisir de redécouvrir Les rats dans les murs, illustré avec toujours beaucoup de brio par Armel Gaulme, dans leur mini-collection Les Carnets Lovecraft.
Alors que 2019 avait connu deux publications, Dagon et La cité sans nom, Les rats dans les murs devrait être le seul ajout pour cette année bizarre qu’est 2020. Le prochain carnet est en effet annoncé pour 2021 (sans préciser de mois, les éditeurs se montrant de plus en plus prudents avec cette crise qui n’en finit pas de finir). Il nous faudra donc se contenter de cette nouvelle pour cette année-ci.
Comme pour les deux premiers carnets, le choix s’est porté sur un texte relativement mineur. Les rats dans les murs, publié en 1924, est plus un hommage à Edgard Allan Poe et son La Chute de la maison Usher qu’un vrai texte du mythos Lovecraftien. On y trouve un homme, héritier d’une vieille famille anglaise, qui, après avoir perdu son unique enfant pendant la guerre 14-18, retourne dans l’Angleterre de ses aïeux pour prendre possession de la vieille demeure familiale, un ancien prieuré décrépit, laissé à l’abandon pendant des dizaines d’années. Les locaux fuient la propriété et refuse d’aider le protagoniste principal dans ses travaux de restauration en raison des nombreuses rumeurs jetant une aura maléfique sur la vielle bâtisse. Peu après avoir terminé les travaux, le nouveau propriétaire commence à faire d’affreux cauchemars lors desquels il entend des armées de rongeurs courir dans les murs.
Après avoir fouillé la demeure, ils se rendent bien évidemment compte qu’elle est construite sur un réseau de cavernes antiques. Ni d’une ni de deux, le baron de la Poer en titre (i.e. notre protagoniste) décide de rassembler quelques scientifiques londoniens pour une expédition vers les insondables abysses. S’en suit une conclusion relativement logique et très lovecraftienne, dont je vous épargne cependant les rebondissements pour vous préserver un plaisir de lecture au cas où le texte ne vous est pas familier (vous pouvez toujours le lire ici en version originale, les textes de Lovecraft étant dans le domaine public).
Gaulme, comme à son habitude, enrichi réellement la lecture du texte par ses croquis, ses crayonnés comme toujours centrés sur l’architecture des lieux et quelques portraits. Les dessins sont beaux et servent vraiment le texte pour installer une ambiance déliquescence au récit, nourrissant notre imagination par exemple avec la dissection de l’un de ces fameux rats, alors même qu’il n’est nullement question de ceci dans le texte. J’émets également ma réserve habituelle : l’écrin est très cher pour un plaisir de lecture et un plaisir visuel aussi court, mais cela reste bien sûr un objet de collectionneur.
Dernier point anecdotique mais qui a malgré tout son importance alors que l’auteur semble toujours inspiré davantage d’écrivain : il n’y a pas un mot sur un élément pourtant révélateur d’un racisme ordinaire de Lovecraft que l’on retrouve dans le texte qui nous occupe. Dans la préface de l’excellent The New Annotated Lovecraft: Beyond Arkham, l’auteur Victor LaValle (La Ballade de Black Tom, dans la collection Une heure lumière, inspiré très largement de l’œuvre lovecraftienne) insiste précisément sur ceci. Le chat du baron, dans Les rats dans les murs, est un chat noir comme la nuit. Pudiquement traduit par « noiraud » dans la traduction de Bragelonne, l’orignal a pour nom « Nigger-man« . LaValle, lui-même afro-américain, explique longuement qu’il a été choqué du terme quand il fut en âge de comprendre son sens profond. Sans tomber dans la frénésie BLM (très largement justifiée, ne me comprenez pas mal !), LaValle explique dans sa jolie préface à quel point cela l’a bloqué pendant des années sur les textes de l’homme de Providence jusqu’à qu’il apprenne à séparer l’homme de l’œuvre. A contextualiser un comportement sans l’excuser. Et c’est bien dommage que Bragelonne n’ai pas profiter de l’occasion pour faire un encart sur ceci, sans tomber dans la polémique mais bien pour reconnaitre que, de tout temps, le racisme reste un fléau qu’il faut comprendre pour pouvoir le combattre. Avoir choisir d’ignorer la question en optant pour une traduction politiquement correcte ne me semble pas du plus grand courage…

 D’
D’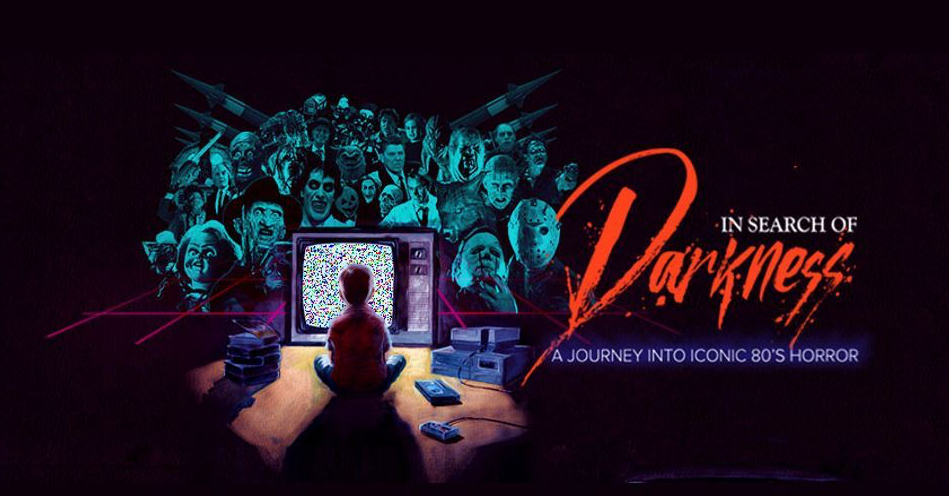 De
De