 La trilogie cosmique, tome I.
La trilogie cosmique, tome I.
De C.S. Lewis, 1938.
Premier roman de fiction rédigé par C.S. Lewis et premier tome de ce qui deviendra la trilogie cosmique (qui devait compter un quatrième tome, laissé inachevé par la mort de son auteur), Au-delà de la planète silencieuse accuse son âge. Rédigé comme une forme d’hommage aux grands textes d’H.G. Wells, que C.S. Lewis cite à plusieurs reprises dans l’incipit et le corps du texte, ce premier tome en prend en fait le contrepied exact. Alors que l’extra-terrestre est forcément vil chez Wells (des morlocks de la Machine à explorer le temps aux martiens de la Guerre des mondes), c’est l’homme lui-même qui, dans Au-delà de la planète silencieuse, est source du mal.
On suit dans ce premier opus les aventures de M. Ransom, philologue de son état, kidnappé par une connaissance de jeunesse pour servir de sacrifice humain sur une lointaine planète après un éprouvant voyage inter-stellaire. Mais Ransom parvient à s’échapper et sympathise avec les peuplades indigènes (non-humanoïde) grâce à ses facultés linguistiques. Il sera alors convoqué par la divinité locale qui cherche à comprendre qui sont ces hommes venus d’une lointaine planète ou, plutôt, quels sont les motifs qui les poussent à des comportements incompréhensibles à leurs yeux.
Et… c’est à peu près tout ce qui se passe dans ce premier tome. Malgré ses maigres 250 pages, en gros caractères, dans l’édition poche de Folio SF, Au-delà de la planète silencieuse cache mal ses défauts d’écriture et de rythme. Lewis, jusque là, s’était essayé à la poésie, aux essais universitaires et à l’apologétique chrétienne, mais pas encore au roman. Et l’on sent qu’il a du mal à trouver un rythme dans ses écrits, alternant maladroitement les dialogues et les scènes plus introspectives. Lewis se perd d’ailleurs plusieurs fois dans des tentatives de description d’expérience sensorielle qui sont plus frustrantes et inutiles que réellement éclairantes pour l’intrigue ou le développement des personnages.
S’il tente de rester proche d’un rythme lent et descriptif, comme celui qu’H.G. Wells adopte dans la guerre des mondes, il le fait, je le répète, avec moins de bonheur. D’autant plus que 40 séparent les deux textes, 40 ans qui ont vu la société et le lectorat se moderniser drastiquement, ce qui aurait dû avoir un impact important sur un texte d’anticipation. Mais c’est là que nous abordons la vraie question de cette critique : Au-delà de la planète silencieuse est-il réellement un roman d’anticipation ? Si, comme son collègue et ami J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis précise bien que son roman n’est en rien une allégorie, peut-on réellement le croire sur parole ?
Tous les lecteurs un peu attentifs vous confirmeront que le Monde de Narnia, au-delà d’être une formidable série de livres pour enfant, sont également une parabole chrétienne où le lion Aslan endosse volontiers le rôle de Dieu. C’est d’autant plus clair quand on lit les deux derniers tomes rédigés par Lewis, qui sont chronologiquement le premier et le dernier tome du Monde de Narnia : ces tomes servent respectivement de genèse et d’apocalypse à son univers. Et, finalement, Au-delà de la planète silencieuse joue sur le même registre, mais avec des ficelles nettement moins subtiles. Ransom, lorsqu’il découvre les différents habitants de Mars (car c’est bien sur Mars qu’il se rend) se rend petit à petit compte qu’il côtoie en fait ce qui s’approche le plus du paradis terrestre (celui-ci ayant disparu des millénaires plus tôt suite à la trahison d’un des êtres supérieurs, enfermé depuis lors sur Terre). Il n’y a qu’un pas, facilement franchi, à tracer un parallèle entre « l’entité supérieure » en charge de chaque planète et un archange, aidé dans sa mission ordonnatrice par un peuplade d’êtres de lumière difficilement visibles que l’on pourrait qualifier d’anges. Et tout ce beau monde de suivre les préceptes d’un être immatériel, qui est partout et nulle part à la fois et qui incarne la connaissance, l’ordre et le pardon. Dieu, donc.
Ajoutez à ceci le fait que « l’être supérieur » (l’Eldila dans le texte) de la Terre est celui qui a suivi la mauvaise voie (Satan, Lucifer, peu importe son nom) et vous avez donc un roman qui nous parle de la chrétienté sans jamais vouloir la nommer. C.S. Lewis lui-même intervient à la fin du roman, lorsque l’on comprend qu’il est en fait le narrateur de cette histoire, pour nous expliquer à demi-mot qu’il a choisi, en accord avec le fictif Ransom, de rédiger un texte de fiction pour faire passer son message en espérant toucher un public plus large. Dans le roman, l’idée est de prévenir l’humanité de l’imminence d’un conflit interstellaire. Mais le message pourrait, pour le même prix, être la révélation chrétienne. Lewis lui-même était à ce moment de sa vie un converti récent. Ce n’est qu’en 1931, sous l’influence notamment de Tolkien et de quelques autres, qu’il se converti au christianisme (de confession anglicane). Et, comme chacun le sait, il n’y a pas pire prosélyte qu’un nouveau converti.
Par ailleurs, on peut douter également de son refus de l’allégorie quand on lit le roman avec une connaissance du contexte historique. Lewis, comme Tolkien à nouveau, a connu les tranchées de 14-18. Nous sommes en 1938 quand il publie ce premier tome de sa trilogie cosmique en devenir. Il assiste, impuissant, à la montée du nazisme en Allemagne et, plus généralement, du fascisme sur le vieux continent. Et c’est là le mal, la source de la guerre cosmique qui se prépare dans son univers de fiction. Difficile de ne pas voir dans la volonté de l’un de deux autres humains présents dans l’histoire, le physicien responsable du voyage, ces thématiques nationalistes qui occupent l’Europe à la veille de la deuxième guerre mondiale. Influencé par le colonialisme, il entends asservir les martien au profit de la race humaine, qu’il veut immortelle en tant que concept (et non en tant que somme d’individus). Le Reich de mille ans n’est pas bien loin. Le parallèle, à nouveau, est donc assez grossier. Si toutes ces thématiques seront reprises plus tard dans le Monde de Narnia, elles le seront de manière nettement plus logiques, subtiles, et s’intègreront bien davantage dans le récit.
Au-delà de la planète silencieuse est donc un roman intéressant pour y voir les débuts romanesques de son auteur. Dans l’histoire de la littérature fantastique anglaise, c’est certainement une œuvre importante de par sa diffusion et l’influence qu’elle exercera sur des générations successives d’écrivains qui seront plus touchés par la SF de la trilogie cosmique que par la fantasy de Narnia. En ce sens, il est salutaire que Gallimard, à travers sa collection Folio SF, ait republié cette trilogie considérée comme un classique, avec une nouvelle traduction, alors qu’elle n’avait plus été publiée en français depuis le milieu des années 60. Est-ce pour autant un bon livre ? La somme de ses faiblesses l’emporte malheureusement sur l’intérêt qu’il peut avoir et je ne peux donc que le déconseiller au lecteur qui s’intéresse à la SF en dilettante. Personnellement, j’enchaînerai quand même avec le deuxième tome, Perelandra, sorti quelques années plus tard, afin de vérifier si les scories de jeunesse, sur la forme comme sur le fond, s’effacent au profit du space-opéra que ce premier tome aurait pu annoncer.
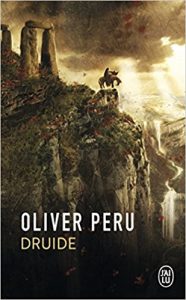 D’Olivier Peru, 2010.
D’Olivier Peru, 2010.
 La trilogie cosmique, tome I.
La trilogie cosmique, tome I.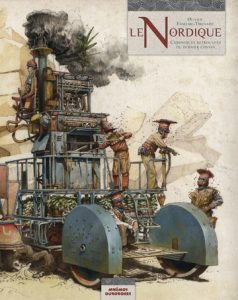 Sous-titré : Chroniques retrouvées du dernier convoi
Sous-titré : Chroniques retrouvées du dernier convoi Sous-titré : Le Sabbat dans Central Park
Sous-titré : Le Sabbat dans Central Park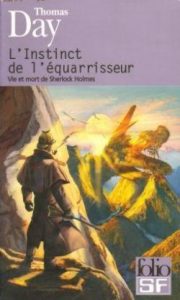 Sous-titré : Vie et mort de Sherlock Holmes
Sous-titré : Vie et mort de Sherlock Holmes