 De John G. Avildsen, 1984.
De John G. Avildsen, 1984.
Est-il possible, aujourd’hui, de dire du mal de Karaté Kid (ou, sous son titre exact : Le Moment de vérité) ? Et je ne parle pas du remake navrant avec le fils Jaden Smith, qui ferait mieux… de ne pas tenter d’être acteur. Mais bien de l’original. Celui de Cobra Kaï et de Daniel-san. Nous touchons ici à un thème déjà souvent abordé dans ce blog : comment dépasser l’auréole de sympathie que confère la madeleine de Proust ? Car si l’on regarde très objectivement cette gentille histoire d’un gamin qui déménage et qui se perfectionne en karaté pour éviter de se faire taper dessus par l’ex de sa nouvelle copine, il n’y a quand même pas grand-chose à sauver.
Une réalisation tristounette, des performances d’enfants acteurs qui ont autant de subtilité qu’un éléphant dans un magasin de porcelaine (je n’arrive pas à traduire la très visuelle expression anglaise : « wooden performance« ), des chorégraphies de combat qui sont … simplement non-existantes, des musiques de « montage/entraînement » qui sont oubliées deux secondes après et une amourette maladroite entre the new kid on the block et Elisabeth Shue, qui a l’air d’avoir dix ans de plus que lui, sans qu’aucune alchimie ne se développe à l’écran entre eux. Sans parler d’une production assez médiocre, grevée sans doute par un budget faible qui a limité grandement les choix de décors, qu’ils soient en extérieur ou en studio.
Reste quelques éléments qui sauvent le film du fiasco : Pat Morita, qui nous est sympathique dès sa première minute à l’écran, quelques séquences d’entraînement, une ambiance générale très eighties qui nous rappelle que la vie était plus facile avant. Mais c’est à peu près tout. Pourquoi, cependant, le film est-il plus naze que Blood Sport, L’Histoire sans Fin ou encore Highlander ? En fait, il n’est pas plus naze. Ni meilleur. C’est simplement que je ne l’ai pas vu enfant. Et que si la nostalgie intrinsèque de l’enfance rend n’importe quel film cheezy des années 80 (au hasard, toute la filmo de John Hughes ?) tout à fait acceptable, lorsque cette nostalgie n’est pas présente, alors reste un regard un peu froid d’un adulte cynique et blasé qui se moque.
Je regrette, du coup, de ne pas l’avoir vu au début des années 90 à l’occasion d’une de ses multiples diffusions télé. Avildsen, le réalisateur de Karaté Kid, venait de filmer le premier Rocky (et avait reçu un oscar pour cela, même si on sait entretemps que Stallone lui-même à jouer un rôle important derrière la caméra sans être crédité pour ce faire) : il signait un Rocky pour enfant qui a inspiré une génération entière à trouver le karaté « cool » et, par extension, à aller s’intéresser à tout un cinéma asiatique qui débarquait alors via les VHS à louer de nos vidéo-store. Toute une époque. Et le développement cet attrait pour le cinéma asiatique auprès des jeunes spectateurs a lui seul justifie l’existence du film.
Mes excuses, Daniel-san, pour être insensible à ton charme suranné. Et donc de ne voir aucun intérêt dans tes suites, tes remakes et autres séries dérivées 40 ans plus tard (la vache, ils ont pris un coup de vieux dans Cobra-Kaï !). Reste alors un film naïf et assez peu inspiré en termes de réalisation, porté par des acteurs au mieux amateurs et qui met en avant une idéologie finalement très reaganienne (le vainqueur à toujours raison, l’amitié avant tout, les filles sont des trophées, etc.) Mais je suis bien conscient que pour la plupart de mes confrères générationnels (et peut-être une partie de mes consœurs ?), cela reste avant tout le film où Daniel-san met une pâtée au méchant blond grâce à l’iconique coup de la grue. Finalement, cela ne se suffit-il pas en soi-même ?

 De
De  De
De 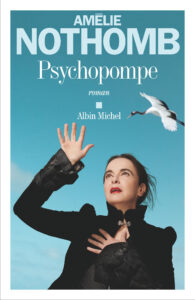 D’
D’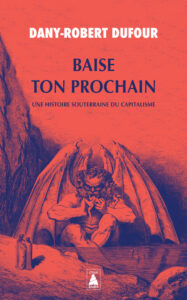 De
De