 De Pierre Noual, 2021.
De Pierre Noual, 2021.
Autre lecture professionnelle, achetée à la formidable librairie du Louvre, ce petit livre des éditions Belopolie, mis en œuvre par l’avocat et historien de l’art Pierre Noual, a le grand mérite d’être une excellente synthèse actuelle de la question de la restitution (des œuvres culturelles au sens large, patrimoine archivistique compris). Ne succombant pas aux dangers de l’émotion partisane, Noual débute son ouvrage par un mise au point linguistique en définissant le périmètre de ce qui est entendu par une restitution. Puis, dans des sections successives, il décrit, multiples exemples à l’appui, quelles sont les pratiques actuelles en termes de restitution dans le cadre général et dans les cas spécifiques des biens spoliés aux juifs avant et pendant la seconde guerre mondiale et dans celui des biens acquis illégitimement pendant les périodes de colonisation.
Si l’on peut regretter que l’ouvrage soit avant tout franco-français, développant par le menu les exemples historiques, de De Gaulle en passant par Hollande, Macron et Chirac, des différents gouvernements successifs, il a le mérite de poser les jalons de cette question essentielle pour les musées et autres lieux de patrimoines d’aujourd’hui. Cette question est autant scientifique ou juridique qu’éthique. Et si, pour cette dernière dimension, il sera laissé à chacun la liberté de fixer son propre compas, les questions juridiques dans un état de droit et les questions scientifiques dans une démarche de préservation du patrimoine et du savoir ne peuvent être négligées.
Pierre Noual, probablement partiellement sujet à une forme de déformation professionnelle, s’attarde assez longuement sur le chapitre juridique. Ce qui peut de prime abord sembler assez aride s’avère cependant réellement passionnant, le droit étant envisagé ici comme il se doit, c’est à dire comme un instrument dédié à la mise en place d’une politique particulière et non comme une fin en soi. Les exemples qui émaillent le texte de Noual sont également tous très pertinents et éclairent si besoin est la grande richesse de cette question et la difficulté d’avoir une position tranchée.
Il est et reste en effet compliqué d’avoir une position absolue sur les questions de restitution. Confronté à des demandes légitimes, les excuses du droit et de la non-ratification de certains traités internationaux sont souvent mises en avant pour préserver (conserver ?) une certaine idée des musées-mondes, telle qu’imaginée au XVIIIe et au XIXe dans notre bonne vieille Europe, alors (et toujours) bien centrée sur elle-même. D’un autre côté, une certaine forme de pression existe également de la part de pays tiers pour ne pas restituer, car ces tiers considèrent que l’accès à la culture ne pourrait pas être garanti dans de bonnes conditions dans le pays en question pour diverses raisons (un musée-monde de type européen n’aurait que peu de sens dans certains pays d’Afrique sub-saharienne, par exemple, pays où la fameuse « identité nationale » que nourrirait ce patrimoine retrouvé est également une construction du colon qui ne représente culturellement que peu de chose pour la population locale). Sans parler du piège du « musée à touristes » qui s’adresserait aux mêmes populations que celles des musées mondes, mais de manière encore plus élitiste, comme le démontre par exemple les spin-offs de différents musées français dans le Golfe.
Bref, la démonstration de Noual tend à convaincre le lecteur qu’il est face à une question complexe. Et si la situation est plus simple dans le cas de œuvres spoliées par le régime nazi (peu de démocrates iront s’insurger contre le principe de la restitution dans ces cas), les choses deviennent directement plus floues quand il s’agit de tracer les contours exacts de ce qu’on considère comme de la spoliation. Dans quelle mesure une vente « forcée » l’est-elle ? Quels sont les critères économiques, forcément fluctuant, à prendre en compte ? Faut-il se fier aux commerçants en arts ou avoir une vision plus historique et/ou sociologique ? Et qu’en est-il du patrimoine à valeur symbolique ? Ou à traçabilité complexe, puisque la recherche de provenance reste la question scientifique clé qui doit précéder une éventuelle décision politique de restitution ?
L’essai a l’intelligence de ne pas répondre à toutes ces questions, qui sont souvent contextuelle à une œuvre, un pays ou une occasion particulière. Elles dépendent également de l’éthique alors en vigueur, concept évoluant au fil des décennies, comme le démontre l’évolution de l’inacceptable au sein d’une même société. Il éclaire cependant le débat en posant quelques jalons de réflexion, quelques mécanismes de questionnement qui ne peuvent que contribuer à une approche moins conflictuelle et plus réfléchie d’un nécessaire positionnement du monde culturel face à l’évolution des sociétés. L’ajout, en annexe de l’essai, de quelques discours politiques et de quelques textes à portée plus normatives, illustre également cette évolution des situations et cette importance de l’instant dans une prise de décision rationnelle et scientifique. Un bel essai qui donne à réfléchir et aide à se construire une opinion personnelle, à défaut de produire une vérité absolue qui ne pourrait être qu’illusoire.

 De
De 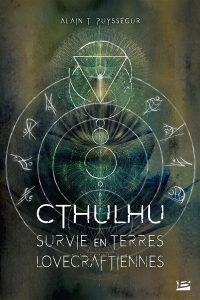 D’
D’
 De
De